 Il n’est pas remonté de l’oubli aussi durablement qu’Emmanuel Bove, Henri Calet ou Raymond Guérin mais l’opiniâtreté de Stéphane Bonnefoi et l’enthousiasme d’éditeurs comme Le Dilettante et Finitude parviennent à nous le rendre vivant. Marc Bernard (1900-1983) qui mourut chez le docteur Paradis est un écrivain forgé à l’optimisme qui se fit lui-même dans un monde où l’on est garçon de course à douze ans, fraiseur à quinze. Il se fait remarquer en 1929 avec la publication de Zig-Zag, chez Gallimard, puis enchaîne les succès en obtenant le Prix Interallié pour Anny (1934) puis le Goncourt (1942) avec Pareils à des enfants …, récit bien émouvant d’une enfance marquée par « le drame réel ». Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, Marc Bernard fut aussi journaliste, et d’abord à Monde, hebdomadaire d’information littéraire, artistique, scientifique, économique et sociale, qui aligne dans son comité directeur les noms d’Albert Einstein, Maxime Gorki et Upton Sinclair. D’obédience communiste, le journal réunit des écrivains parmi lesquels Henry Poulaille. Dans les colonnes de Monde, Marc Bernard déclare qu’il existe un art prolétarien. Il défendra cette position en fondant, en 1932, avec Poulaille et Tristan Rémy, le Groupe des écrivains prolétariens.
Il n’est pas remonté de l’oubli aussi durablement qu’Emmanuel Bove, Henri Calet ou Raymond Guérin mais l’opiniâtreté de Stéphane Bonnefoi et l’enthousiasme d’éditeurs comme Le Dilettante et Finitude parviennent à nous le rendre vivant. Marc Bernard (1900-1983) qui mourut chez le docteur Paradis est un écrivain forgé à l’optimisme qui se fit lui-même dans un monde où l’on est garçon de course à douze ans, fraiseur à quinze. Il se fait remarquer en 1929 avec la publication de Zig-Zag, chez Gallimard, puis enchaîne les succès en obtenant le Prix Interallié pour Anny (1934) puis le Goncourt (1942) avec Pareils à des enfants …, récit bien émouvant d’une enfance marquée par « le drame réel ». Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, Marc Bernard fut aussi journaliste, et d’abord à Monde, hebdomadaire d’information littéraire, artistique, scientifique, économique et sociale, qui aligne dans son comité directeur les noms d’Albert Einstein, Maxime Gorki et Upton Sinclair. D’obédience communiste, le journal réunit des écrivains parmi lesquels Henry Poulaille. Dans les colonnes de Monde, Marc Bernard déclare qu’il existe un art prolétarien. Il défendra cette position en fondant, en 1932, avec Poulaille et Tristan Rémy, le Groupe des écrivains prolétariens.
Mais c’est le romancier ayant exploré chaque centimètre de la ville de Nîmes (il y est né) dont on se souvient de façon plus nette. Dans son Histoire de la littérature française, Jacques Brenner le présente comme celui qui fit de Nîmes « le personnage principal d’un triptyque romanesque, Les Vivants et les Morts. » Comme il est dit par ce fin connaisseur des Lettres, Marc Bernard « n’a pas choisi un personnage conducteur pour la promenade à laquelle il nous invite. » Nîmes en est le centre et la circonférence. Marc Bernard est fait d’encre et de sang nîmois. On ne se doutait pas qu’un enfant du pays puisse un jour explorer, avec autant de science et d’humanité, Sarcelles, ville nouvelle.
À la demande de Jean Duché, son éditeur, il s’installe trois mois durant dans ce grand ensemble, alors coruscant, et rédige un livre publié en 1963 selon la seule méthode qui est la sienne, celle de l’immersion fraternelle. « Je ne voulais rien affirmer que je n’aie connu personnellement », souligne-t-il dans sa préface. Il habite allée Jacques-Rivière, à côté de voies urbaines portant les noms de Paul Claudel, Marcel Proust et Paul Valéry. André Gide y a sa place. Tout est impeccable dans ce paysage tracé au cordeau et qui embaume la campagne voisine où pousse le froment, le seigle et des arbres fruitiers. Il semble que le bonheur y soit possible. Le logement est une divinité où l’ouvrier « se déchausse sur le seuil comme s’il entrait dans une mosquée. » C’est une ville pilote où l’on flâne et où l’on s’initie, aux heures perdues, à la reliure, au tissage et à la vannerie. « Le pain sarcellois a une légèreté, un croustillant, un doré qui en font un délice, une invention moderne. » Tout est bon au goût et sublime aux yeux.
Aux abords de la ville nouvelle, le vieux Sarcelles, avec ses murs croûteux et ses cours délabrées, dégage une impression de basse-fosse. On ne regrette pas de quitter ses ruelles méandreuses pour rejoindre la cité « rigoureusement ordonnée, hérissée de tours. » La culture y est invitée qui permet aux Sarcellois d’aller à la rencontre de Henry de Monfreid, de Christiane Rochefort, de Pierre Gascar, d’entendre Jean Vilar parler théâtre. On y organise des expositions consacrées à Van Gogh et à Albert Camus. La ville nouvelle est l’emblème de la culture qui vient au peuple. « On se prend à rêver que ceux qui s’en écartaient parce qu’elle leur semblait inaccessible, en la trouvant à leur porte, au bout de la rue, au centre de la cité, seront tentés de la mieux connaître. » L’architecte Labourdette prévoit même, parmi ses constructions à venir, la création d’un laboratoire afin de faire naître des vocations scientifiques.
Mais la ville blanche n’est pas tout à fait le Jardin d’Éden et Marc Bernard ne manque pas d’en montrer les aspects boiteux. Un chapitre sur la délinquance expose des faits qui coïncident avec ceux d’aujourd’hui. Son enquête lui fait découvrir qu’on y brise des lampadaires, des vitres de voitures, des fenêtres, des étalages. « On lance la pierre et l’on file sur des semelles de vent, dans la nuit. » Des bandes s’affrontent, surin au poing. Une jeune caissière est violée par quatre garçons, puis rançonnée. La vie n’est pas toujours belle à Sarcelles et Marc Bernard prévoit les lézardes et le chaos dans cette prose chaleureuse, une prose de proximité, qui fait de ce témoin suprême, un voyant au grand cœur. Guy Darol
SARCELLOPOLIS, Marc Bernard, Éditions Finitude, 221 p., 17 €
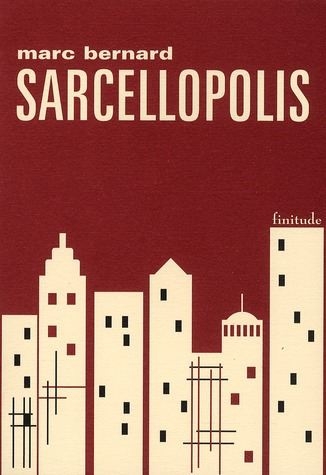
LE SITE DES EDITIONS FINITUDE



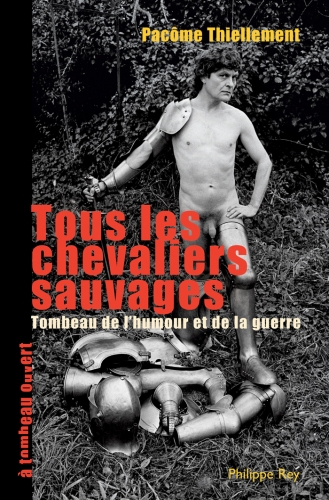


 Il n’est pas remonté de l’oubli aussi durablement qu’Emmanuel Bove, Henri Calet ou Raymond Guérin mais l’opiniâtreté de Stéphane Bonnefoi et l’enthousiasme d’éditeurs comme Le Dilettante et Finitude parviennent à nous le rendre vivant. Marc Bernard (1900-1983) qui mourut chez le docteur Paradis est un écrivain forgé à l’optimisme qui se fit lui-même dans un monde où l’on est garçon de course à douze ans, fraiseur à quinze. Il se fait remarquer en 1929 avec la publication de Zig-Zag, chez Gallimard, puis enchaîne les succès en obtenant le Prix Interallié pour Anny (1934) puis le Goncourt (1942) avec Pareils à des enfants …, récit bien émouvant d’une enfance marquée par « le drame réel ». Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, Marc Bernard fut aussi journaliste, et d’abord à Monde, hebdomadaire d’information littéraire, artistique, scientifique, économique et sociale, qui aligne dans son comité directeur les noms d’Albert Einstein, Maxime Gorki et Upton Sinclair. D’obédience communiste, le journal réunit des écrivains parmi lesquels Henry Poulaille. Dans les colonnes de Monde, Marc Bernard déclare qu’il existe un art prolétarien. Il défendra cette position en fondant, en 1932, avec Poulaille et Tristan Rémy, le Groupe des écrivains prolétariens.
Il n’est pas remonté de l’oubli aussi durablement qu’Emmanuel Bove, Henri Calet ou Raymond Guérin mais l’opiniâtreté de Stéphane Bonnefoi et l’enthousiasme d’éditeurs comme Le Dilettante et Finitude parviennent à nous le rendre vivant. Marc Bernard (1900-1983) qui mourut chez le docteur Paradis est un écrivain forgé à l’optimisme qui se fit lui-même dans un monde où l’on est garçon de course à douze ans, fraiseur à quinze. Il se fait remarquer en 1929 avec la publication de Zig-Zag, chez Gallimard, puis enchaîne les succès en obtenant le Prix Interallié pour Anny (1934) puis le Goncourt (1942) avec Pareils à des enfants …, récit bien émouvant d’une enfance marquée par « le drame réel ». Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, Marc Bernard fut aussi journaliste, et d’abord à Monde, hebdomadaire d’information littéraire, artistique, scientifique, économique et sociale, qui aligne dans son comité directeur les noms d’Albert Einstein, Maxime Gorki et Upton Sinclair. D’obédience communiste, le journal réunit des écrivains parmi lesquels Henry Poulaille. Dans les colonnes de Monde, Marc Bernard déclare qu’il existe un art prolétarien. Il défendra cette position en fondant, en 1932, avec Poulaille et Tristan Rémy, le Groupe des écrivains prolétariens. 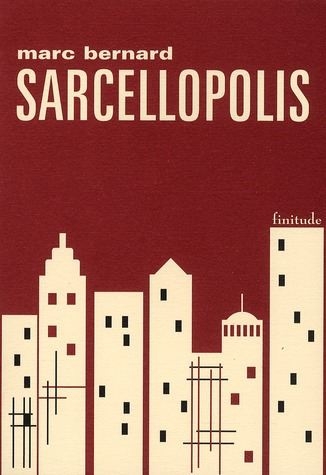
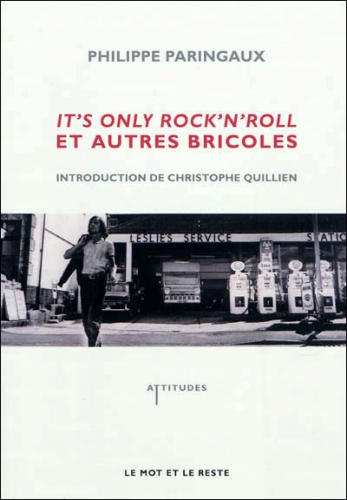


 Il faut un ciel bleu, un soleil comme une forge et l’oisiveté en traversin pour goûter pleinement au récit de Raymond Guérin. Une aventure à peu près immobile mais vécue en altitude, à hauteur de Curzio Malaparte et de sa casa « Come Me », voici ce que nous conte l’auteur de L’Apprenti, le mirifique inventeur de La Confession de Diogène. On nous le réveilla en même temps que Bove, Calet, Forton, Gadenne, Hyvernaud, Paroutaud. C’était au temps des années 80, celui de la new wave mais aussi de la revue Les Grandes Largeurs qu’emmenaient Dominique Gaultier et Guy Ponsard et ils nous emmenaient loin. De cette époque où l’on ressuscitait des morts, nous ne sommes guère descendus de la hune où se voit très bien chaque réapparition de Raymond Guérin.
Il faut un ciel bleu, un soleil comme une forge et l’oisiveté en traversin pour goûter pleinement au récit de Raymond Guérin. Une aventure à peu près immobile mais vécue en altitude, à hauteur de Curzio Malaparte et de sa casa « Come Me », voici ce que nous conte l’auteur de L’Apprenti, le mirifique inventeur de La Confession de Diogène. On nous le réveilla en même temps que Bove, Calet, Forton, Gadenne, Hyvernaud, Paroutaud. C’était au temps des années 80, celui de la new wave mais aussi de la revue Les Grandes Largeurs qu’emmenaient Dominique Gaultier et Guy Ponsard et ils nous emmenaient loin. De cette époque où l’on ressuscitait des morts, nous ne sommes guère descendus de la hune où se voit très bien chaque réapparition de Raymond Guérin.