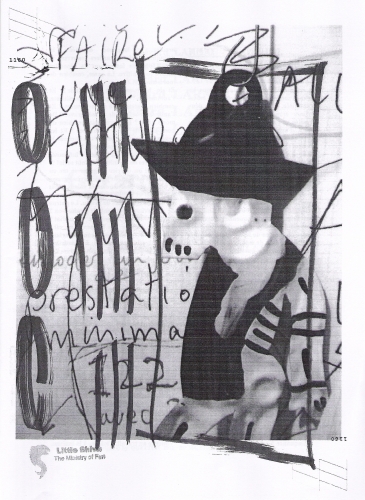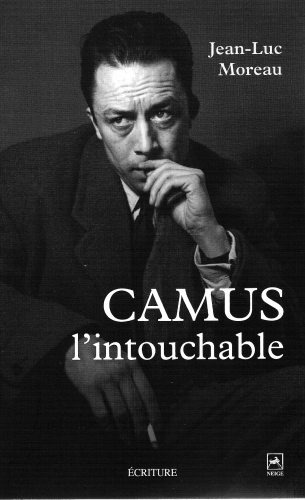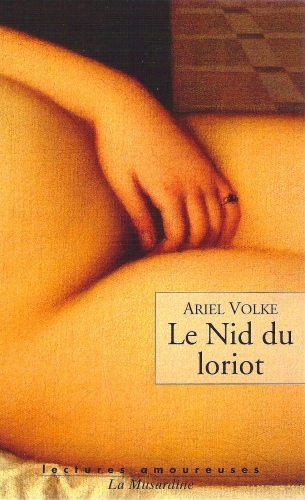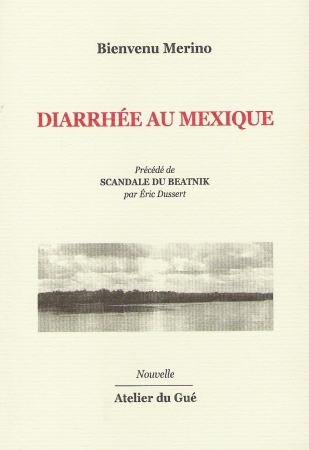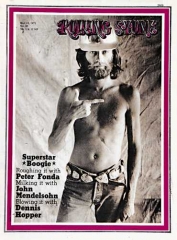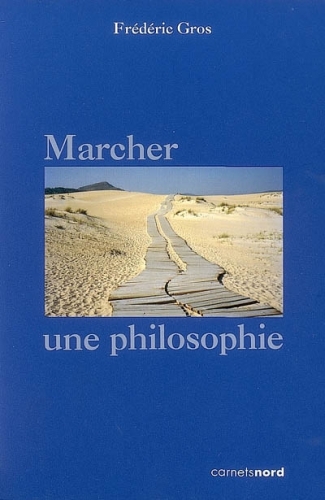Auteur feu de salve de La société de consommation (1970) puis de La consommation des signes (1976), Jean Baudrillard fut le créateur de la revue foutripétante Utopie. Satrape du Collège de Pataphysique depuis 2001, Jean Baudrillard continua par ses ouvrages et ses articles à penser boutefeu, par-delà la mêlée.
Ne dit-on pas que ses théories, à partir de Simulacres et simulation (1981) ont influencé les réalisateurs de la trilogie Matrix ?
Cet entretien, emmené par Lionel Ehrhard, Bernard Neau, François et Thérèse Richard, est paru dans le n°5/6 de la revue Dérive portant pour titre La question du pouvoir. Il s’est déroulé en octobre 1976, peu avant la publication de La volonté de savoir de Michel Foucault.
BN : Une question pour commencer, manière de donner le la.Tu dis quelque part : « Il n’y a plus de pouvoir, lui aussi est déliquescent. » Dans l’idée classique d’une prise de pouvoir, c’est-à-dire de mainmise sur des appareils institutionnels et rouages publics/spectaculaires (parlementarisme, ministères, média…), que penser des diverses « stratégies » de pouvoir des communistes ? Est-ce qu’ils y croient vraiment aux représentations du « pouvoir » ? Ou est-ce que d’après toi, ils ne fonctionnent pas un peu là-dessus ?
JB : Tu sais, je crois qu’ils n’en veulent pas du pouvoir. Ils en ont la hantise, du moins au niveau des partis qui ont une réelle possibilité de la prendre, comme l’italien ou le français par exemple. Au temps de Staline, ils étaient sûrement avides de pouvoir, en tout cas du bureaucratique, plus que du politique au sens classique du terme. Or, depuis leur déstalinisation spectaculaire et tardive, le ressort politique chez eux s’est brisé en ce que, lorsqu’ils s’essayèrent à devenir autonomes (stratégie d’eurocommunisme, etc…), comme par hasard, ils ont soigneusement éludé la question, et ça ne peut pas être accidentel. Pas accidentel, assurément la position du PCF lors des événements de 68, ou celle plus récente du PCI en Italie. Il faudrait se demander pourquoi ils ont perdu ce ressort politique. En fait, tout le monde l’a un peu perdu. Le pouvoir, après tout, on ne sait plus très bien où il est. En tout cas, c’est une question à creuser, d’une extrême importance. Il faudrait se demander pourquoi communistes et marxistes en général n’en veulent plus du pouvoir,pourquoi ce fameux ressort s’est cassé ; probablement par une espèce de déperdition totale de la volonté de puissance politique. Je crois maintenant qu’ils se disent qu’il doit bien y avoir du politique quelque part, une espèce de pouvoir… à prendre ou à laisser. Mais cette analyse est prise aussitôt à revers par l’idée qu’il n’y en a peut-être plus du pouvoir ! J’ai l’impression que leur réflexion stratégique s’inscrit toute entière dans ce paradoxe qu’ils en aient clairement conscience ou non. Par exemple, je pense à Berlinguer qui déclarait lors des élections italiennes : « Il ne faut pas avoir peur de voir les communistes prendre le pouvoir. » Phrase étonnante. Ca peut tout  vouloir dire ! Il ne faut pas avoir peur parce que si nous prenons le pouvoir cela ne changera rien au régime capitaliste, et de toute façon, nous ne nous risquerons pas à le prendre. Ou, moi Berlinguer je n’ai pas peur de le prendre. Ou bien encore tout à fait le contraire : « J’ai peur de voir les communistes prendre le pouvoir en Italie ! » On le voit, il y a toutes les raisons éventuelles pour un communiste d’avoir peur.
vouloir dire ! Il ne faut pas avoir peur parce que si nous prenons le pouvoir cela ne changera rien au régime capitaliste, et de toute façon, nous ne nous risquerons pas à le prendre. Ou, moi Berlinguer je n’ai pas peur de le prendre. Ou bien encore tout à fait le contraire : « J’ai peur de voir les communistes prendre le pouvoir en Italie ! » On le voit, il y a toutes les raisons éventuelles pour un communiste d’avoir peur.
BN : Est-ce qu’ils ne restent pas aussi prisonniers du mythe d’une rationalité interne au système, à savoir, d’une conception téléologique du pouvoir, du type le capitalisme aujourd’hui par son auto-développement et le jeu de ses contradictions en arrive au stade du fruit mûr à cueillir ?
JB : Ca aussi, c’est contradictoire ! Tu ne prends pas le pouvoir parce que le Capital est en crise et que tu ne veux pas gêner sa crise. S’il faut attendre que le Capital ne soit plus en crise pour le prendre en héritage, quand prendront-ils alors le pouvoir ? Bon, il est certain qu’ils guettent la passation du pouvoir par le Capital et qu’ils ont enterré l’idée d’une prise de pouvoir par la violence révolutionnaire. En fait, ils n’en finissent pas d’attendre, d’attendre que le pouvoir leur soit conféré par une instance souveraine, en l’occurrence le Capital. Mais si tu attends que le Capital ait terminé sa crise, il n’y aura plus jamais de pouvoir à prendre car dans ce cas le Capital le garde ! D’un côté, le Capital est en crise permanente, de l’autre, qu’attendent les communistes : la fin de la crise ? Et, ils sont les premiers à dire que le développement du Capitalisme ne peut qu’amener crises sur crises. C’est d’une logique délirante ! Regardez le livre de Gianfranco Sanguinetti (en tout cas de Censor), Véridique rapport sur les dernières chances de sauver le capitalisme en Italie. La thèse n’est pas fausse, en toute logique, même si finalement elle ne correspond pas à grand-chose. Le Capital refile le pouvoir gestionnaire ou politique au PC quand il sent bien qu’il ne peut plus s’en sortir. Donc, de deux choses l’une. Ou le Capital s’en sort et il ne donne pas le pouvoir aux communistes, ou, s’il ne s’en sort pas, le PC se garde bien de le prendre car il n’a aucune raison de le prendre dans ces conditions. C’est un cercle vicieux incroyable, mais qui constitue pour le PC un système de défense qui lui évite l’épreuve du pouvoir. Alors, y a-t-il vraiment pouvoir à prendre ? La question reste en suspens.
Regardez le livre de Gianfranco Sanguinetti (en tout cas de Censor), Véridique rapport sur les dernières chances de sauver le capitalisme en Italie. La thèse n’est pas fausse, en toute logique, même si finalement elle ne correspond pas à grand-chose. Le Capital refile le pouvoir gestionnaire ou politique au PC quand il sent bien qu’il ne peut plus s’en sortir. Donc, de deux choses l’une. Ou le Capital s’en sort et il ne donne pas le pouvoir aux communistes, ou, s’il ne s’en sort pas, le PC se garde bien de le prendre car il n’a aucune raison de le prendre dans ces conditions. C’est un cercle vicieux incroyable, mais qui constitue pour le PC un système de défense qui lui évite l’épreuve du pouvoir. Alors, y a-t-il vraiment pouvoir à prendre ? La question reste en suspens.
TR : Est-ce qu’au bout de cette logique viciée il n’y aurait pas l’idée que le gestionnaire n’est pas celui qui a le pouvoir réel. Que, dans un jeu d’alternance du pouvoir, celui qui perd, et reste dans l’opposition, gagne à sa façon ?
JB : Peut-être mais qu’a-t-il à gagner ? D’ailleurs, si tu vas par là, les communistes gèrent en Italie presque la totalité du pays. A mon avis, la gestion c’est un piège pour les ratés du politique.
FR : Je voudrais te poser une question sur le rapport entre ce que tu appelles le code qui se placerait au-dessus des appareils de pouvoir existants, et principalement l’appareil d’Etat, et le code du Capital qui engloberait dans son fonctionnement tous les appareils de pouvoir. Comment fais-tu le lien entre la force des appareils de répression, d’exploitation, et ta théorie : le Capital comme code qui toujours dépasse ces appareils ?
JB : Hum… Je n’ai jamais réussi à envisager ce machin. J’y vois vraiment rien du tout. J’y suis tout à fait allergique.
BN : Il semble qu’il n’y ait à ce niveau que deux façons d’analyser la ou les questions du pouvoir, qui consistent, l’une, à dégager ce fin réseau capillaire fait de microstratégies subtiles qui travaillent davantage dans les trous et la fragmentation sociale, bref dans l’espace pas clair du « quotidien », que sur la forme concentrée, spectaculaire et phallique de ce machin omnipotent et quand même bel et bien existant : l’Etat dans la société civile. L’autre, et Henri Lefebvre par exemple y demeure encore attaché, c’est, je crois, le défaut marxiste par excellence de ne voir forme suprême de pouvoir politique que l’Etat. Or il apparaît que Michel Foucault, travaillant dans la première hypothèse, est dix fois plus opérant, en tout cas va beaucoup plus loin, que toutes les tentatives d’analyse marxisantes de l’Etat. Car, chez ces derniers, incontestablement, il y a blocage…
JB : Oui… Lefebvre s’est ramassé là-dessus de superbe manière. Pardi, il se braque sur une Instance extraordinaire qui aurait une centralité, une possibilité de distribution rationnelle et organisée des pouvoirs…
FR : … Mais toi, est-ce que tu ne fais pas de la notion de code un objectif central qui serait un peu l’équivalent de l’Etat dans la théorie marxiste ?
JB : Non. Ce code-là emporte le reste. Il ne permet justement pas de repérer UNE instance et il est, dans son évolution, destructeur de toutes les instances. Le Capital, appelons-le comme ça, n’est pas lié à des instances repérables. Il n’est pas donné de toute éternité, tel qu’en lui-même, n’est-ce pas, il ne pourrait changer. Ila pu avoir sa phase, disons axiomatique, centralisée, concurrentielle…, avec une régulation étatique, mais ça, ce n’est pas sa véritable définition. C’est beaucoup plus une machinerie qui n’a pas de principes, d’axiomes et de finalités, et qui est aujourd’hui en train véritablement de se déployer comme telle. Cette machinerie passe par-dessus toutes les institutions, les prend en écharpe ou les déborde largement, y compris et en particulier celle de l’Etat. Elle peut se permettre de démembrer s’il le faut, de décentraliser s’il le faut, et il y a un bon moment que ça opère comme ça. On est encore en retard d’une révolution là-dessus…
FR : En fait, ça voudrait dire que cette notion flottante et envahissante de pouvoir est plus pernicieuse en ses effets que celle plus restrictive et repérable d’Etat ? JB : Là, on en arrive à Foucault. Chez Foucault, il n’y a plus de pouvoir, dans le sens d’une analyse classique du problème. Il ne cherche plus ni causalité ni finalité. Sur ce point, il a dépassé l’analyse marxiste et toutes celles qui l’ont précédées. Incontestablement, il rompt avec une continuité d’analyse essentiellement liée à un déterminisme historique qui était peut-être vraie avant mais qui n’a plus guère de prise aujourd’hui. Par contre, il trouve le pouvoir interstitiel, moléculaire, diffracté mais il appelle encore ça du pouvoir, et le terme de pouvoir est encore là, toujours central.
JB : Là, on en arrive à Foucault. Chez Foucault, il n’y a plus de pouvoir, dans le sens d’une analyse classique du problème. Il ne cherche plus ni causalité ni finalité. Sur ce point, il a dépassé l’analyse marxiste et toutes celles qui l’ont précédées. Incontestablement, il rompt avec une continuité d’analyse essentiellement liée à un déterminisme historique qui était peut-être vraie avant mais qui n’a plus guère de prise aujourd’hui. Par contre, il trouve le pouvoir interstitiel, moléculaire, diffracté mais il appelle encore ça du pouvoir, et le terme de pouvoir est encore là, toujours central.
BN : Est-ce que ce n’est pas chez lui un terme trop générique, une entité fourre-tout et pleine, explicative de toutes les formes répressives ? Est-ce que ce n’est pas le « chapeau » ultime qui recouvrirait toutes les logiques de domination, pas un concept mais une métaphore ouverte, un point de cristallisation tangible de toutes les forces « mauvaises », éclatées et éparpillées dans les diverses institutions ?
JB : En effet, peut-on encore appeler pouvoir quelque chose qui est diffracté à ce point ? On peut dire que la notion de pouvoir est la dernière fable qui se raconte chez Foucault. C’est un terme qui reste transcendant à son champ d’analyse, il reste malgré tout une structure fondamentale. Et cette structure, elle a beau être micro, ça veut toujours dire qu’il y a des manipulés et des manipulants, des dominés et des dominants, etc. La structure du pouvoir comme définition demeure belle et bien. Simplement elle est passée dans un pointillé extraordinaire au lieu d’être centralisée quelque part. Il y a certainement là un progrès de l’analyse marxiste, mais l’analyse au sens radical du terme, c’est-à-dire analyser, dissoudre le concept de pouvoir, n’est pas faite chez Foucault. Le concept de pouvoir n’est pas soumis à la même généalogie que tout le reste. C’est la dernière parade, mais qui reproduit quand même la structure, ou la mythologie du pouvoir, même sous sa forme subtile, moléculaire. Et ici, on pourrait faire à Deleuze ou Lyotard le même procès sur le plan du Désir.  L’idéologie-désir qui prend ses attaches dans la psychanalyse sous une forme cadrée, massive, même si elle en est dérivée, mûrit dans l’antipsychanalyse deleuzienne sous forme de désir diffracté, schizé, nomade, en ballade… Le désir reste toujours une acception pleine. Et le pouvoir, chez Foucault, c’est la même opération. Ce qui était analysé, massif, axial chez les autres, devient complètement disséminé, éclaté,mais reste tout de même cette conception structurelle du pouvoir ! Bon, c’est vrai qu’il est pulvérisé le pouvoir mais, à mon avis, Foucault ne mesure pas ce qu’il peut y avoir, pas seulement de pulvérisé,mais encore de pulvérulent, de foutu. Ou il n’y a plus, ou il se passe quelque chose entre la mort et le pouvoir qu’il ne peut plus alors analyser en ces termes.
L’idéologie-désir qui prend ses attaches dans la psychanalyse sous une forme cadrée, massive, même si elle en est dérivée, mûrit dans l’antipsychanalyse deleuzienne sous forme de désir diffracté, schizé, nomade, en ballade… Le désir reste toujours une acception pleine. Et le pouvoir, chez Foucault, c’est la même opération. Ce qui était analysé, massif, axial chez les autres, devient complètement disséminé, éclaté,mais reste tout de même cette conception structurelle du pouvoir ! Bon, c’est vrai qu’il est pulvérisé le pouvoir mais, à mon avis, Foucault ne mesure pas ce qu’il peut y avoir, pas seulement de pulvérisé,mais encore de pulvérulent, de foutu. Ou il n’y a plus, ou il se passe quelque chose entre la mort et le pouvoir qu’il ne peut plus alors analyser en ces termes.
FR : Ce dépassement du pouvoir dans la mort, ne peut-on dire que c’est l’utopie du pouvoir qui se représente son au-delà ? Actuellement, la notion de crise représenterait peut-être l’au-delà du pouvoir, sa dissolution complète, voire la disparition de la notion de pouvoir qui, pourtant, subsisterait réellement dans des appareils concrets ?
JB : Tu en reviens alors à un complot du pouvoir, une stratégie de pouvoir. Même si c’est une stratégie conscience, c’est encore une tactique généralisée.
BN : Restons sur Foucault. Je me demande s’il n’y a pas chez lui, à travers son travail généalogique, une sorte de code magique du pouvoir qui serait repérable dans l’inscription des corps. Est-ce que ce pouvoir ne serait pas, en dernier ressort, quelque chose comme une chose-en-soi, un non-catégorisable qui se laisserait repérer dans la trame des discours (travail de l’archiviste) mais qui se situerait en fait tout à fait ailleurs. Peut-être effectivement sur le front des luttes… Ou alors, est-ce que le pouvoir n’aurait pas sa petite herméneutique singulière. Je veux dire qu’il ne se laisserait lire, ne se donnerait à déchiffrer qu’au scrutateur philosophe/professeur, et cela, davantage dans les documents que dans les corps eux-mêmes. Bref, pour décrypter ce qui peut se passer réellement sur ou à travers les corps, il faut aller y voir, dans les couches sédimentaires du discours accumulé par l’Histoire, dans les bibliothèques plus peut-être que dans les prisons ou dans les alcôves. Là, pour moi, il y a quelque chose qui cloche…
JB : Peut-être… En tout cas, chez Foucault, on n’est jamais très loin d’une instance déterminante, il n’y a pas de pièges puisqu’on vient de voir qu’il ne pose pas la question de l’origine ni de la finalité du pouvoir. Mais le Pouvoir est là, toujours en tant que structure donnée. On se demande : qu’est-ce qu’il fait encore là, ce truc ? Bon, cette structure, on ne peut pas la prendre à revers puisqu’elle a été centralisée, puis diffractée. Et puis, demeure toujours l’idée que ce Pouvoir devrait quand même disparaître. Je dirais que ça fait partie de la connotation même de Pouvoir. Toutefois, il n’y a rien chez Foucault qui te permette de penser à une quelconque réversion du Pouvoir. Cette structure reste et elle ne peut que rester structurelle. De même, si tu veux, chez Deleuze il reste le Désir comme idée-force. Ca se pose en termes d’intensité et d’énergétique. Foucault , lui, fait au moins l’économie du Désir. Il n’en a pas besoin mais, encore une fois, le Pouvoir persiste comme secteur structurel.
BN : Chez des gens comme Deleuze et Lyotard, dont les stratégies de discours (on n’en sort pas du discours et des stratégies !) me semblent pourtant assez différer, le pouvoir ne serait-il pas le grand fantôme qui leur court après ? Ceci étant repérable, peut-être, au niveau de mythes spectaculaires lancés à grands coups de cymbales sur le marché des idées du genre nomadisme, dérive, schyze généralisée, etc, etc. Pourquoi ces théories points de fuite ? N’auraient-ils pas en commun, finalement, une certaine hantise de la récupération ?
JB : Oui… Enfin, je ne sais pas. On peut admettre qu’ils sont récupérés à partir du moment où ils font l’hypothèse du Pouvoir ou du Désir. Ce dont je suis sûr, en tout cas, c’est que Foucault échappe à la récupération ; il se taille une tranche là où il n’y a ni en-deça ni au-delà. Il dit simplement : moi, je décris un fonctionnement. Et, en un sens, même si on peut discuter, les exemples qu’il se donne et qui semble assurer la validité de ses analyses, ce qu’il dit est incontestable. Enfin, maintenant, la généalogie, c’est malgré tout une analyse… de plain-pied. Oui, il y a quand même un petit relent de résolution qui traîne, mais enfin, s’il décrit les micro-mécanismes du pouvoir, c’est pour signaler que c’est à ce niveau qu’il faudra intervenir politiquement. Maintenant, savoir s’il y a rapport effectif du travail aux luttes concrètes, ça, je n’en sais rien. Il pense qu’il y a cohérence. Peut-être.
FR : Quand tu décris certains mouvements, sur les signes, les sujets, le refus du travail qui seraient la réversion du pouvoir dans Le miroir de la production…
JB : … Je n’y crois plus. pour moi, j’avoue que ça se ballade un peu…
LE : … Mais est-ce que poser en non-pouvoir, ce n’est pas une attitude de pouvoir ? J’aurais tendance à le croire. Il serait intéressant dans cette optique de diffraction du pouvoir d’analyser tous les impouvoirs ou prétendus tels qui, de fait, pourraient bien être des « accidents » de pouvoir dans tous les sens du terme. JB : Si tu fais là encore référence à Foucault, je te dirais qu’il pose la lutte contre le pouvoir au niveau du corps, de la surveillance, de la discipline, etc… Chez lui, on résiste de front à un quadrillage. La question du « non-pouvoir », ça c’est autre chose. Il ne se la pose pas. Dans son projet, il n’y a pas de non-pouvoir, on est dedans, c’est micro, oui, mais il y a une perspective de lutte contre, en termes de rapport de forces. De sorte qu’il n’y a pas de Politique de Foucault ou, en tout cas, elle n’est pas à la mesure de son analyse. Mais qu’est-ce que « l’impouvoir » maintenant. Ce truc-là, on en entend parler, l’impouvoir ?...
JB : Si tu fais là encore référence à Foucault, je te dirais qu’il pose la lutte contre le pouvoir au niveau du corps, de la surveillance, de la discipline, etc… Chez lui, on résiste de front à un quadrillage. La question du « non-pouvoir », ça c’est autre chose. Il ne se la pose pas. Dans son projet, il n’y a pas de non-pouvoir, on est dedans, c’est micro, oui, mais il y a une perspective de lutte contre, en termes de rapport de forces. De sorte qu’il n’y a pas de Politique de Foucault ou, en tout cas, elle n’est pas à la mesure de son analyse. Mais qu’est-ce que « l’impouvoir » maintenant. Ce truc-là, on en entend parler, l’impouvoir ?...
LE : … ( ! )
FR : Mais quand tu parles de la critique radicale ou de l’échange symbolique, on a l’impression que c’est un lieu en-deça ou au-delà de la problématique du pouvoir ?
JB : Si j’avais une opinion là-dessus, elle serait en opposition à Foucault – tout en se référant à son gigantesque projet. Selon moi, du pouvoir, il n’y en a pas. Que serait de l’impouvoir qui s’opposerait à du pouvoir ? Là où il y a structure de pouvoir, réversiblement et dans lemême instant, elle se détruit elle-même. Toute accumulation est reprise aussitôt par une désaccumulation, toute structure de pouvoir est minée d’emblée. Au fond, toute structure cherche sa propre mort, y compris celle du pouvoir. Partout, et pas seulement dans des groupes particuliers, des minorités. Autrement dit, le pouvoir n’est jamais une structure unilatérale, comme ce qui peut se dégager encore de chez Foucault. Le pouvoir, ça s’échange. Il parcourt un cycle où il peut se réversibiliser, c’est-à-dire passer par tout un dispositif incroyable et un processus complexe de séduction qui fait qu’il n’y a pas, en fait, de dominés d’un côté, de dominants de l’autre. Un peu comme la victime et son bourreau. Il y a toujours une circularitéde pouvoir qui s’échange. Et ça n’existe que comme ça. Aussi, quand il n’y a plus de circularité minimum, on ne suppose même pas le pouvoir. Et aujourd’hui, dans cette absence de circularité symbolique minimum, le pouvoir disparaît. Y’en a plus ! Le pouvoir, c’est aussi – mais dans une représentation parfaitement rationnelle en tant que structure polaire – quelque chose qui s’échange symboliquement, c’est-à-dire qui parcourt un cycle où tout le monde est pris et où la séduction est beaucoup plus puissante que les rapports de force.
BN : C’est certainement en cela que tu dis que « le symbolique va toujours au-delà du politique. »
JB : Au fond, le pouvoir n’est jamais là comme structure, telle qu’on puisse le décrire, il n’est pas repérable dans des personnes ou des groupes ni même dans des institutions.
BN : D’après toi, la « lutte des classes » ne serait donc pas descriptible ou plus exactement, elle ne serait pas descriptible en termes de rapport de forces ?
JB : C’est une hypothèse simplifiante qui te permet de choisir un versant du rapport de forces. Ca ne change rien d’être d’un côte ou de l’autre. « Rapport de forces », je veux bien, bon, si tu veux, bien sûr il y en a mais s’il faut se substituer à l’Autre, vouloir l’Autre versant, s’il y a conquête d’un camp par l’autre, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C’est oublier qu’il y a toujours réversion quelque part. A partir de là, il ne peut y avoir que des effets de pouvoir.
FR : n ne peut alors parler de refoulement du symbolique. Les rapports de forces et les appareils d’Etat seraient refoulement de la circulation du pouvoir au niveau symbolique ?
JB : Il peut y avoir effet de pouvoir à partir du moment où l’on envisage une interruption de cette circularité. Tout ne peut n’être que réversible, recherche du cycle de sa propre mort, abolition de soi dans le cycle. Le symbolique, pour moi, c’est ça en définitive. Si tu choisis une position simplifiante qui te permet de te camper d’une part, en renvoyant tout le reste de l’autre, ça n’exclut en rien le processus de réversibilité. De fait, toute rationalité unilatérale est condamnée d’avance.
BN : Il y aurait donc, à t’en croire, opacité totale de notre univers symbolique ?
JB : Oui. Tout concourt à l’occulter.
FR : Est-ce qu’on ne pourrait pas dire que la production serait une « stase » et que la circulation du pouvoir, se rompant, produirait cette « stase », bien compacte ?
JB : On fait toujours du pouvoir quelque chose d’irréversible ! En principe, il est immortel (comme la production) ; il est structurel, monolithique, il se reproduit, il s’accumule… On ne manque jamais de relier l’irréversible au pouvoir : la production, la croissance, etc. Mais injecte la moindre dose de réversibilité dans toutes nos institutions et tout devient intenable.
FR : C’est le travail mort qui s’érige sur le travail vivant. De fait, la critique se situerait du côté du travail vivant qui sans arrêt est dévoré par le travail mort. Chez Marx, il y a une coupure radicale entre les deux.
JB : Mais n’y a-t-il pas de techniques efficaces de stase, comme tu dis ? L’interruption du truc, est-ce qu’à un moment donné, la production, la valeur, ou le pouvoir, n’arrive pas à bloquer la machine à produire de l’irréversible ? Ils n’y réussissent jamais qu’apparemment. Si tu prends l’accumulation économique, il y a du spectaculaire, du quantifiable, par conséquent, depuis quelques années, c’est indéniable, on assiste à un processus d’accumulation et donc, en apparence, à un processus irréversible. Mais y a-t-il eu vraiment succès d’un processus d’interruption de la réversibilité et un démarrage irréversible dans une direction quelconque ? Auquel cas, nous sommes dans un système délirant. Ou bien peut-on décrire des phénomènes d’accumulation économique, un leurre efficace, certes, et sur lequel ça travaille, ça fonctionne… On peut hésiter entre ces deux hypothèses. En tout cas, je vois ça comme insoluble. Bien sûr, tout dépend du parti pris d’analyse mais si l’on opte pour l’analyse radicale de toute symbolique, il n’y a pas d’accumulation mais bien un simulacre. Aussi, si tu crois à une déperdition irréversible du symbolique, tu admets alors un système qui a réussi à fonder son pouvoir là-dessus et, de toute manière, on constate aujourd’hui qu’ayant cru fonder du pouvoir, en fait, cette accumulation se retourne contre elle-même. Alors on en revient au même point, c’est seulement l’hypothèse qui a changé.
FR : Est-ce qu’on ne peut pas dire que toute accumulation de valeur et de pouvoir ne se fait finalement que pour l’activité d’inscription, de comptabilité ? Il y aurait un axiome, un code qui appellerait la production, l’accumulation, toute exhibition de pouvoir par rapport à un code déjà déterminé, qui porterait une sorte de regard sur toute l’activité ; ou bien, cette activité comptable, obsessionnelle de la société ne serait-elle pas, en partie, une rationalisation a posteriori d’un mouvement d’accumulation du pouvoir en tant que tel, comme chez Foucault ? De la force qui s’accumule, qui fait pouvoir, se sépare et qui, après coup, tiendrait un discours identifiable à celui de l’activité comptable, de la valeur, de la croissance ?
JB : Comment te répondre ? Ca reviendrait à chercher une origine du pouvoir, à supposer un moment où il n’y en avait pas, ou moins, ou plus ? Chez Deleuze également on sent bien la recherche d’une origine du pouvoir : l’idée du Désir par une espèce de torsion du pouvoir.
BN : Surtout quand on soupçonne, chez lui et quelques autres, en gros, qu’il faut éviter tout repérage dans l’ordre des valeurs. D’où, la dérivite, le nomadisme… Puisqu’ils partent tous d’une volonté de non-repérage, c’est qu’ils présupposent d’une façon obligée une origination de ces valeurs, un point d’ancrage au commencement. On peut se demnader s’il n’y aura pas, toujours, repérage fatal des valeurs…
FR : A la limite, c’est le concept de société qui est en cause, comme si la société avait besoin, pour se représenter, d’un mythe fondateur de la prise du pouvoir (par une ethnie pseudo-originelle ou tout ce qu’on voudra) sans lequel on ne pourrait plus donner légitimité à un type de société, à une culture, à une civilisation…
JB : Parlons-en de la notion de société ! Le social, c’est du résiduel. Mais tout peut l’être et aboutir à une socialisation totale. En fait, y compris les sociétés dites primitives qui ne sont, à la fois, ni des sociétés ni bien sûr primitives. Le social, c’est vraiment une instance qui se développe comme un chancre mou, ça indique déjà une pétrification. Alors si tu es dans un échangé réversible, continu, il n’y a plus cette « prise » du social.
FR : Ce résidu fantasme la notion de pouvoir et, à partir de là, essaie de s’instituer comme pouvoir réel…
JB : C’est là où prend le pouvoir… Dans certaines sociétés, quand un nombre d’individus d’un même groupe échappaient à l’échange symbolique, ils devenaient résiduels et disponibles pour une manipulation du social. Ainsi étaient-ils liquidés par le fait que surgissaient des espèces de prophètes qui les emmenaient se suicider ailleurs. Le résidu est exterminé au fur et à mesure puis à un moment donné, il ne l’est plus. Advient alors une possibilité de cristallisation d’un pouvoir, d’un chef. Aujourd’hui, le social est là, un peu comme le langage chez Lacan : c’est une structure avec laquelle tu as d’avance partie liée, comme s’il n’y avait plus aucune alternative possible.
BN : Est-ce que le résiduel ne s’expliquerait pas d’abord au plan symbolique et, pour ce qui concerne nos sociétés modernes, par le fait que, comme disait Nietzsche, on est empêtré dans les rêts du langage et des valeurs, et que s’est développé un tel hypercriticisme qu’on est arrivé à une attitude de doute systématique sur chaque notion, sur chaque point de valorisation ? La valorisation n’est plus possible à partir de là. Il arrive donc un moment où tout le champ est complètement ratissé, alors il faut produire un nouveau à tout prix, un impossible nouveau, auquel on ne croit guère et que l’on sait éphémère, dérisoire. On fait comme s’il n’y avait plus de sorties possibles, hors du langage, d’un langage saturé et d’une symbolisation qui semble finalement ne jamais s’arrêter de mourir. De cette entropie vient peut-être la prolifération de ces théories et de ces philosophies « nouvelles » qui sont toutes, qu’elles le veuillent ou non, référentielles à ce fatalisme psycholinguistique qui nous gouverne… qui nous pourrit. Mais de là à dire que les valeurs sont mortes, se sont envolées ! Elles traînent et flottent et puent derrière votre dos – comme le cadavre de Dieu. Bref, on n’en sort pas de la CROYANCE mais, bien sûr, on ne la connaît que trop… Peut-être que c’est justement ICI que vient se briser toute possibilité de discours de/sur le pouvoir…
JB : Ca, c’est encore plus grave… D’après toi, tout ce qu’on a pu raconter là, est-ce que ça renvoie à autre chose que du langage ? C’est le hic… symbolique, pour moi, une terminologie différente pour quelqu’un d’autre. Est-ce que ça n’est pas aussi un effet de langage ? Franchement, je n’en sais rien. tant mieux si c’est un modèle de simulation et si tu en joues comme tel ! Comment sortir des effets de langue même et surtout par une théorie strictement marquée ? Il ne me semble pas possible de trouver autre chose qu’un modèle de simulation, une substance plus réelle que les autres… D’où ma méfiance à l’égard de la théorie. Je ne dirais pas que je n’y crois plus, du moins je pense qu’elle doit être une hypersimulation, et il s’agit de la rendre encore plus destructive. On ne peut pas sortir de là. La théorie n’est qu’un moyen. on est branché sur quelques termes génériques : symbolique, réversibilité… En définitive, il faut essayer de passer par le moins de modèles terroristes de simulation …
BN : Si je comprends bien, et afin de prévenir toute illusion scientifique pour ceux qui en aurait encore, l’interprétation déborderait toujours une quelconque possibilité de « vérité » de la critique ; elle serait toujours interprétation d’une simulation et la simulation elle-même, l’interprétation…
FR : J’ajouterais ceci : est-ce qu’au-delà d’un discours « nihiliste » qui analyserait tout en termes de simulation, on ne rencontrerait pas un projet qui, à travers toute cette déconstruction de type nietzschéen serait le mouvement même du dépassement affirmatif ?
JB : Oui, je le sens bien. C’est peut-être parce que l’on ne peut pas échapper à une référence minimale. Bien sûr qu’il y a un mouvement de ce type-là mais sans tomber dans l’illusion que le modèle que vous construisez subisse sa propre loi, qu’il soit réversible à la simulation énoncée. Ce qui est certain dans ces théories actuelles auxquelles on faisait allusion et qui sont radicales, qui vont loin, c’est qu’il y a toujours un terme qui reste terme, qui n’est jamais exterminé, qui reste là comme du plein. On l’a vu tout à l’heure à propos de Foucault et Deleuze par exemple…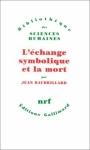 FR : Tout de même, dans L’Echange Symbolique et la Mort, quand tu parles au début de la production, tu décris la crise et le refus du travail et tu laisses apercevoir comme possible ce qu’on peut appeler la critique du salariat, voire son dépassement…
FR : Tout de même, dans L’Echange Symbolique et la Mort, quand tu parles au début de la production, tu décris la crise et le refus du travail et tu laisses apercevoir comme possible ce qu’on peut appeler la critique du salariat, voire son dépassement…
JB : C’est une question d’amplitude aussi bien dans les mouvements dont on parle (femmes, etc…) que dans les concepts que l’on met en place dans un texte théorique. A court ou moyen terme, il y a un effet de réversion possible sur tel ou tel secteur. On le voit dans les mouvements d’anti-pouvoir, mais le système aussi a sa réversion et il t’implique dans son cycle. Ce jeu-là, il faut le reconnaître. C’est un truc tactique. Et à partir de là, on peut faire mouche sur un secteur déterminé…
LE : Même chose pour ton analyse des rapports de forces : il y a toujours un rapport de forces dans la séduction…
JB : … Je ne crois pas. Partout, la séduction s’oppose à la production et aux rapports de forces, c’est-à-dire que laséduction est réversible alors que la production, elle, suit une ligne irréversible où apparaissent en des termes clairs la force, les rapports de forces, etc…
LE : La séduction est une arme comme une autre et même parfois plus efficace qu’une autre, donc doublement caractérisée…
JB : Il y a tellement de définitions possibles de la séduction ! Disons que, dans le sens commun, la séduction passe dans l’idéologie et qu’elle est envisagée, au fond, comme un principe idéologique de camouflage des rapports de force. C’est-à-dire que le pouvoir se reproduirait à travers de la séduction. On ne peut pas, en tout cas, en donner une explication psychanalytique car elle ne fait rien de la séduction, elle l’explique en termes d’économie, d’investissement, de libido, de rapports énergétiques. A mon sens, elle est ce lieu où il serait impossible de repérer un objet et un sujet, un pôle actif et un pôle passif. C’est donc une force oui, mais qui exclut toute manipulation unilatérale.
LE : Ton lieu imaginaire alors …
(rires)
JB : OK ! Prenons-là au niveau des rapports de pouvoir et ne parlons pas de la séduction de type individuelle, amoureuse (encore qu’elle se joue comme ça aussi). La séduction n’est pas seulement production de plaisir ou de désir. Là où elle passe, il y a abolition d’un pouvoir unilatéral. En ce sens, si tu veux, toute la séduction sexuelle abolit la séduction. Il s’agit alors d’accumulation, de production d’un potentiel de plaisir… ce qui n’est justement plus séduction et il faudrait reprendre les analyses conventionnelles des sociétés de type hiérarchique ou symbolique. Car chez elles, entre ceux qui apparemment tiennent le rôle de dominants ou de dominés je crois que s’inscrivent des rapports de séduction et, dans cette mesure-là, il n’est plus question de dominants et de dominés. Dans notre logique à nous, on y voit du supérieur et de l’inférieur mais en fait, ce qui se passe est différent. Dans le régime féodal, on voit le suzerain qui profiterait de l’Autre sous d’apparents rapports de protection mais je crois que c’est tout autre chose qui se joue. FR : Je pense à Salo ou les 120 journées de Sodome. Pasolini attribue le pouvoir à l’Etat comme étant, sous sa forme odieuse, la vérité qu’on ne peut (ou qu’on ne veut ?) pas voir en face, celle du Capital.
FR : Je pense à Salo ou les 120 journées de Sodome. Pasolini attribue le pouvoir à l’Etat comme étant, sous sa forme odieuse, la vérité qu’on ne peut (ou qu’on ne veut ?) pas voir en face, celle du Capital.
JB : C’est-à-dire que, dans ce film, tu as une contre-épreuve du pouvoir entendu au sens commun. C’est peut-être pour cette raison qu’il est insupportable… Pour ma part, je l’ai vu et mal vécu, sinon comme un mauvais objet. Cela dit, c’est un film fort. Le film a plu à certains parce qu’ils pouvaient y retrouver leurs fantasmes. Dans ce film, et du fait que la situation est tout entière du même côté, il n’y a plus le minimum de réversibilité possible, à savoir que la mort des uns et des autres ne peut plus être mise en jeu puisqu’on dit aux uns vous êtes morts quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quant aux autres (les quatre mecs), ils sont déjà morts. C’est cette absence totale de réversion qui est intolérable. Pour moi, on ne peut pas fantasmer sur ce film. Dans Salo, séduction et réversion sont exterminées. Et, à propos de ce film, je me suis interrogé sur l’histoire du masculin et du féminin qui est tellement liée aux questions de pouvoir. On dit, le pouvoir est exclusivement masculin et, sans se laisser piéger dans la définition du masculin et du féminin en termes de sexe réel, dans ce film, l’affirmation du pouvoir mâle est relancée. Peut-être parce qu’il est sodomite/sadien, donc non-féminin au sens organique, pourtant il va plus loin car il montre que dans ce type de pouvoir, le féminin (qui n’a évidemment jamais trait à la femme réelle) est le seul principe de réversion du système.
BN : Pourtant, dans Salo, l’idée maîtresse est que le plaisir ne peut s’échanger qu’entre hommes. La femme ne tient qu’un rôle annexe dans la circulation du plaisir, qui passe aussi par le logos… Simple objet de plaisir peut-être (et encore, pas dans la parole !), en tout cas, objet de mépris.
JB : Ceci dit, il se trouve qu’il n’y a pas que les hommes qui puissent prendre du plaisir : il peut y avoir des femmes qui se substituent au masculin.
BN : Quand même, je crois qu’il est vraiment dificile de sortir de la mâle-langue…
LE : D’une façon générale, les femmes font l’écarté sitôt qu’on s’explique cartes en main : à la fois dé-dialectisées et « dé-dialectalisées ».
JB : Je ne sais pas. On connaît pas mal de femmes qui peuvent prendre ce plaisir-là, à condition, tu me diras, de devenir des mecs ! Mais c’est aussi une façon de dire : il y aurait une alternative possible de le faire en restant des femmes – ce qui n’est pas vrai. Si tu prends la définition comme telle, tu ne peux avoir qu’un exercice masculin dominant et, du côté du féminin, tu ne peux avoir que la destruction de cet exercice… Le mélange de ces deux utopies n’est sans doute pas possible. Il ne peut pas y avoir de « libération de la femme » de type rationnel, organisé en clan partant en guerre contre les abus du pouvoir de l’Autre.
LE : Si on ne voit pas, c’est vrai, les prémices d’un tel « mélange », si on ignore encore comment il se fera, qu’est-ce qui nous autorise à le dire impossible ?
JB : La preuve, d’une certaine façon, c’est l’intolérable dans Salo pour tout mec qui va voir ce film. Et c’est justement, à mon avis, cette part de féminin que nous avons en nous qui refuse le film. A la vision de ce film, pas de différence femme/homme, dans la mesure où c’est pas quelque chose qui colle au sexe unique, unilatéral de chacun… C’est important car ça déplace les histoires de pouvoir, à savoir ce qui se dit de lui comme construit comme un sexe : phallus, signifiant, etc… Bref, tout ça encore qui se situe du même côté.
LE : Et il semble bien que la civilisation occidentale crève de ça, en fait : de ce que son discours est étouffé par son phallus !
JB : Oui, il est possible que ce soit là où ça s’engorge. Rires. Mais il est encore vrai que dans d’autres types de cultures (indienne, par exemple, ou dans les dispositifs japonais de relations entre les sexes durant la période dite féodale), tu  n’as pas cette polarisation phallique. Vous avez vu L’Empire des sens ? Il s’oppose totalement à Salo par le fait qu’à un moment donné du film se produit un renversement complet de situation qui nous mène jusqu’à une mort non-déficitaire. Je ne sais pas si on peut en tirer une conclusion mais il se passe quelque chose qu’on ne verra jamais dans Salo et qui se produit par la femme.
n’as pas cette polarisation phallique. Vous avez vu L’Empire des sens ? Il s’oppose totalement à Salo par le fait qu’à un moment donné du film se produit un renversement complet de situation qui nous mène jusqu’à une mort non-déficitaire. Je ne sais pas si on peut en tirer une conclusion mais il se passe quelque chose qu’on ne verra jamais dans Salo et qui se produit par la femme.
FR : dans ce film, la domination est tellement masculine qu’elle devient domination de l’idée de pouvoir ;le pouvoir devient une « idée de » purement volontariste, le rictus de la domination destructrice à l’égard de toute chose et notamment des deux sexes.
JB : Ils n’en viendront jamais à bout, on le sait bien, c’est vieux comme Hegel, au moins… Ils ne pourront que les faire crever ces vieux schémas de domination. Mais tu as raison, c’est toujours dans l’idée que le pouvoir peut s’absolutiser. Or il ne le peut pas, c’est simplement un fantasme, cette possibilité que le pouvoir absolu soit d’un seul côté. Mais c’est évidemment une idée qui fait rêver la Raison. C’est un fantasme de la Raison, ce qu’elle nous propose comme idée de Pouvoir, unilatéral, immortel, accumulatif…
LE : Dans une certaine mesure, nous et le pouvoir absolu, ça fonctionne un peu comme une religion.
JB : C’est-à-dire Dieu ?
LE : Je me le demande… Quoi qu’il en soit, c’est la même transcendance condamnée à l’a priorisme. Il y a un mouvement ascensionnel de toute façon, au sommet duquel se trouverait quelque chose de mythique. Pour moi, c’est un processus analogue, même si je force un peu. Ceci dit, qui touche à la Raison de trop près y décèle de la religiosité, je crois.
JB : Seulement Dieu comme être absolu, c’est finalement assez récent dans nos civilisations.
LE : Très souvent la Raison s’arrogeant la scientificité devient l’alibi à certaines formes de religiosité. La Raison aussi est un mobile. Il suffit de se retourner pour y trouver de la croyance.
JB : Est-ce que le pouvoir, c’est vraiment la forme rationalisante, matérialisante, absolutiste de quelque chose ? Je pencherai plutôt à dire qu’un pouvoir politique a circulé avec un minimum d’échange symbolique, mais aujourd’hui ça tendrait à disparaître.
TR : La notion même de pouvoir ne serait-elle pas intervenue au moment où on a commencé à croire au progrès ?
JB : On peut dire qu’il y a « progrès » là où il y a en effet possibilité d’une accumulation primitive. Mais où ça commence ? Maintenant rentre en jeu la croyance en un progrès fondamental, la possibilité d’un dépassement au bout d’une chaîne historique. On peut faire l’hypothèse qu’il y a eu du progrès, du pouvoir, mais quelles en seraient les conditions précises d’apparition ? En faisant une « préhistoire » du pouvoir, on voit qu’il n’y en eut pas vraiment, mais bien un système de parenté, des règles d’obligations… Mais il est difficile maintenant de parler de pouvoir politique au sens où nous l’entendons… On peut admettre que la société dite occidentale a mis en place tout un code dont l’acceptation actuelle du terme pouvoir pourrait rendre compte mais cela pour une période qui aura duré relativement peu de temps puisqu’on est déjà dans une phase où cet âge d’or du politique est révolu. Donc on ne peut faire une généalogie progressive du pouvoir et dire que ça a existé mais que ça n’existe plus, et ne pas faire au contraire de ce qu’on tente généralement, à savoir une ontologie du politique.
BN : On m’y voit revenir. Je ressasserai encore ceci : que les gens sont piégés du fait que la langue crée des invariantes, des valeurs molles. C’est assez marrant de voir cette inflation théorique de l’Occident, cet hyperthéorisme qui fait qu’à partir d’un modèle préétabli ayant force de Loi, on va se déterminer contre ou en dérive, en faisant le commentaire du commentaire du commentaire du commentaire… Il y a une vérité fondamentale du Verbe que l’on affirme ou que l’on déconstruit par une posture critique ou encore à laquelle on se refuse radicalement (nihilisme fonctionnant toujours comme théologie négative)… Et cette civilisation, d’un Logos initial dans lequel viendrait s’inscrire le code de tous les pouvoirs possibles, c’est probablement la seule définition possible de l’Occident. Car elle est bien la seule dont les discours de pouvoir fonctionnent essentiellement sur cette volonté motrice de vérité plus que de savoir à proprement parler. Volonté de vérité du discours du sexe, de ceux de l’économie politique, du droit, de l’art… Et sur ce point, la gnoséologie marxiste qui s’arroge le droit à « l’universalité » est encore étroitement marquée par cette machinerie métaphysique d’un Logos souverainement vrai et absolu. L’attitude superstitieuse de cette civilisation (qui présuppose à la base une ontologie fondamentale du politique) est ce qui fait qu’elle (re)connaît que tout est dans le langage et que le langage est Tout, mais en affirmant toutefois en une ultime redondance que, non décidément, les enjeux sont ailleurs, que toute se joue et se résoud dans du « hors-langue »…
FR :… Il y a un texte dans Utopie qui dit que si l’on va jusqu’au bout de l’analyse, ce qu’il faut prendre au pied de la lettre, ce sont les miroitements de surface, la totalité du spectacle. Le simulacre est à prendre absolument au sérieux. Je pense aux mises en scènes que nous montent Giscard, Chirac et consorts, et à toutes ces histoires de crises au sein de l’appareil d’Etat. Est-ce que cette mise en scène ne serait pas pour masquer un pouvoir-force ou, au contraire, ne faut-il pas voir qu’il n’y a, en fait, que des mises en scènes ?
JB : La définition du simulacre, c’est pareil, il ne faut pas l’absolutiser. C’est une notion qui peut prendre un sens à un moment donné. Par exemple, le cinéma est envahi par l’Histoire sous le mode d’une résurrection nostalgique. Même s’il y a une néo-figuration historique, elle demeure encore simulacre dans le sens où l’Histoire est ce qui est perdu en tant que référentiel et il faut combler ce trou par une évocation tous azimuts de tous les référentiels possibles, qu’ils soient fascistes ou révolutionnaires. Tout est bon pour cacher cette fin de l’Histoire. Ce qui existe aujourd’hui dans le Politique est dépassé. Le Politique réel, s’il a eu lieu, serait un jeu contradictoire de la représentation. La tendance va vers une simulation généralisée. Alors, ou on fait une Pataphysique du simulacre, ou bien on suppose que le système va se réversibiliser sous forme de catastrophe. On en arrivera donc à la vision d’un système qui, à force d’avoir voulu accumuler, maximiser le Pouvoir, la valeur, etc… s’écroule sous son poids. Est-ce un fantasme ? Ou serait-ce le dernier fantasme d’une utopie révolutionnaire ?
FR : Est-ce que ça ne renvoie pas à un pouvoir laïque ? La mort du politique, du symbolique… de l’Histoire, en définitive, nous met face à face avec des appareils de pouvoir tout à fait banals. Et les gens savent pertinemment qu’il n’y a que ça. JB : A ce propos, avez-vous Les Hommes du Président ? C’est un exemple extraordinaire de la pensée de gauche qui aboutit à la dénonciation du scandale… Non, Watergate ce n’est pas un scandale ! Jamais n’apparaît dans l’affaire que la vérité du Capital c’est Watergate et que ce sont les autres,les opposants, la Gauche, qui sont en train de régénérer moralement tout le truc en criant au scandale. Le capitalisme a toujours été ça. Il est bien plus intelligent que ses dénonciateurs. Les statistiques disent qu’au fond, les 2/3 des Américains ne savent pas ce qu’était le Watergate.Et pour ceux qui sont les moins politisés, ça veut dire que eux savent bien ce qu’est le régime dominant. Il ne s’agit pas de mettre Ford à la place de Nixon ou Carter à la place de Ford : la grosse masse des Américains sait bien, en réalité, qu’il n’y a pas d’alternative, du moins sur ce plan-là, et surtout pas en moralisant le Capital…
JB : A ce propos, avez-vous Les Hommes du Président ? C’est un exemple extraordinaire de la pensée de gauche qui aboutit à la dénonciation du scandale… Non, Watergate ce n’est pas un scandale ! Jamais n’apparaît dans l’affaire que la vérité du Capital c’est Watergate et que ce sont les autres,les opposants, la Gauche, qui sont en train de régénérer moralement tout le truc en criant au scandale. Le capitalisme a toujours été ça. Il est bien plus intelligent que ses dénonciateurs. Les statistiques disent qu’au fond, les 2/3 des Américains ne savent pas ce qu’était le Watergate.Et pour ceux qui sont les moins politisés, ça veut dire que eux savent bien ce qu’est le régime dominant. Il ne s’agit pas de mettre Ford à la place de Nixon ou Carter à la place de Ford : la grosse masse des Américains sait bien, en réalité, qu’il n’y a pas d’alternative, du moins sur ce plan-là, et surtout pas en moralisant le Capital…
BN : On a l’impression que la bourgeoisie, le Capital n’ont plus de conscience morale, mais que la Gauche, elle, se charge d’en avoir pour eux.
JB : C’est clair que depuis toujours le Capital est immoral. Et, pour l’attaquer ou le comprendre, il faut être au moins aussi immoral que lui !
TR : Ce qui a frappé les gens, ce n’est pas le scandale du Watergate, mais la puissance avec laquelle il a été dénoncé.
JB : Oui, dans la mesure où ça faisait partie du même mythe.
BN : Ca s’explique aussi, peut-être, par un dernier chatouillement de la conscience puritaine. Pardi, un homme qui a juré sur la Bible, qui va à l’Eglise chaque dimanche, et qui trahit en plus le fidéïsme en la loi US !
TR : C’est peut-être là lemodèle d’une « révolution culturelle » aplliquée aux pays occidentaux par et pour une espèce de régénérescence du pouvoir…
JB : Ou alors l’idée qu’il serait toujours possible, dans un sytème de pouvoir, de mettre à mort le pouvoir, ce qui revient à la réversibilité, même si ça passe à travers le mythe américain de l’individu. Dans ce cas, on revient dans le système où lepouvoir est ce qui doit, un jour ou l’autre, être mis à mort. Ici, nous sommes dans un système où le pouvoir ne peut plus être mis à mort.
FR : On peut dire que c’est l’Etat qui met en scène ces mythes. JB : Je pense au personnage de Deep Throat. On ne sait pas qui il est… On dit qu’il s’agissait d’un personnage du Parti Républicain… Le Parti Républicain aurait décidé de se débarrasser de Nixon devenu trop encombrant et ce serait eux qui auraient manipulé les journalistes du Washington Post. Les Présidents américains sont pratiquement obligés d’avoir été victimes de deux ou trois attentats, sinon d’en mettre en scène. Ford, deux fois. Nixon aussi. De faux attentats, manifestement, pour conserver cette légitimité profonde du pouvoir.
JB : Je pense au personnage de Deep Throat. On ne sait pas qui il est… On dit qu’il s’agissait d’un personnage du Parti Républicain… Le Parti Républicain aurait décidé de se débarrasser de Nixon devenu trop encombrant et ce serait eux qui auraient manipulé les journalistes du Washington Post. Les Présidents américains sont pratiquement obligés d’avoir été victimes de deux ou trois attentats, sinon d’en mettre en scène. Ford, deux fois. Nixon aussi. De faux attentats, manifestement, pour conserver cette légitimité profonde du pouvoir.
LE : On réclame l’être-dupe de leur spectaculaire virginité, en vue, contradictoirement et comme par magie, de restaurer ladite virginité ! Toute mise à mort, dès lors, ne sera que parodique, quasiment rituelle ou accidentelle, et ne libérera que ce qui excède, c’est-à-dire le minimum de perte nécessaire à la reproduction, quelque part où il y a faille, entre l’apaisement du besoin et l’accomplissement du désir.
JB : L’exigence est là, satisfaite et court-circuitée par des simulations. Watergate ne représente, en dernier lieu, qu’une simulation fascinante venue détourner un espoir fou de réversibilité. Mais il existe différentes sortes de simulacres ! 1968 est une simulation qui parvient tout de même à mettre en place un processus de désintégration réel du pouvoir… C’est vrai que le pouvoir est défié à un niveau plus profond que dans Watergate où il met en scène sa propre mort pour ensuite se reproduire, mais on ne sait ce qui a pu se reproduire après Mai 68.
LE : Peut-être ne reste-t-il que l’Effet face à une illusion de pouvoir que n’ont jamais paru contrôler que des guides conscients de n’être que les accompagnateurs ou, à la rigueur, les anticipateurs d’un mouvement.
JB : Voilà peut-être, en effet, le secret : savoir que le pouvoir n’existe pas ! Ca confère une immoralité et une efficacité extraordinaires. On l’avait dit pour les Papes qui savaient que Dieu n’existe pas au contraire de toute la poulaille chrétienne. On l’a dit aussi pour les banquiers qui savent eux que l’argent n’existe pas, que l’argent ça ne se possède pas. Le piège serait de s’identifier à un élément, d’en avoir le monopole et de croire que le pouvoir est fondé là-dessus. Pas du tout ! Les vrais politiques doivent savoir que c’est l’inverse. C’est sur le vide, le creux central, que s’organise le pouvoir ! Le Politique, quand il a une vraie valeur, c’est sur le mode symbolique : l’existence du vide. Alors que tous les autres naviguent sur du plein, du rapport de forces… Ca, c’est naïf ! Je me demande aujourd’hui s’il y a encore une possibilité de concept stratégique du vide et si les Nixon, Carter, Giscard sont capables d’une stratégie de foyer d’absence autour de quoi tout le reste gravite…
LE : Il n’y aura plus de personnages historiques ?
JB : Il ne peut plus y en avoir et ça veut dire que cette définition-limite, radicale du pouvoir, est de moins en moins possible dans notre système. C’est donc la fin du politique dans le bon sens du terme.
© Dérive n°5/6, mai 1977