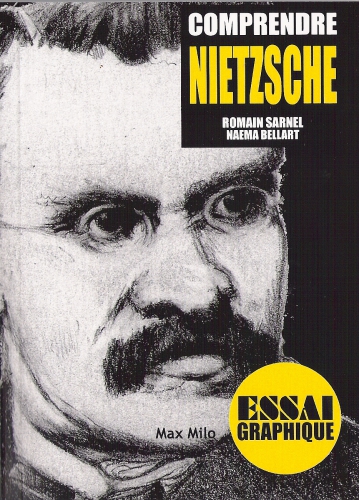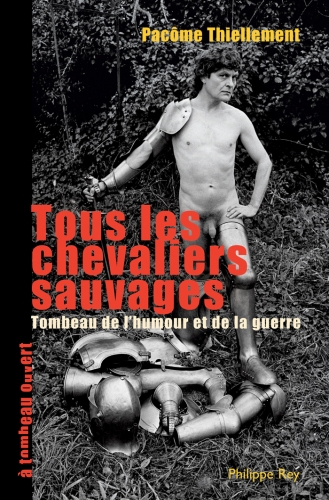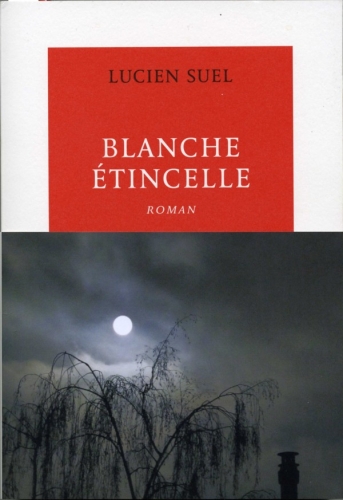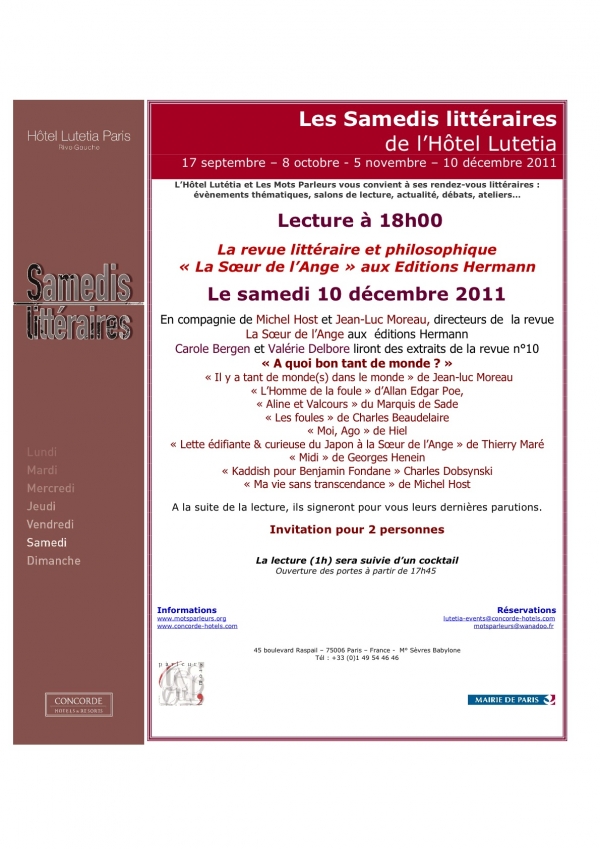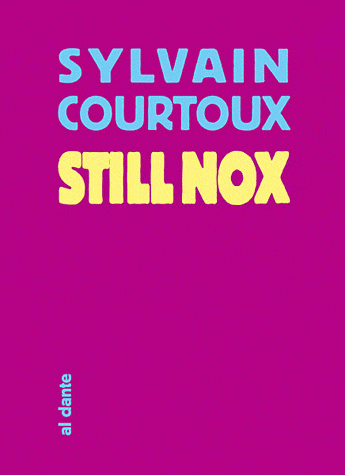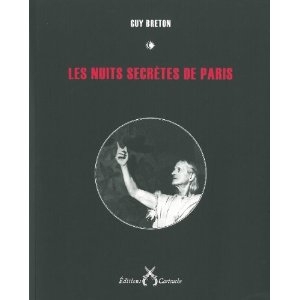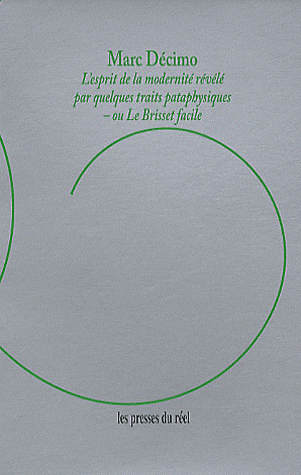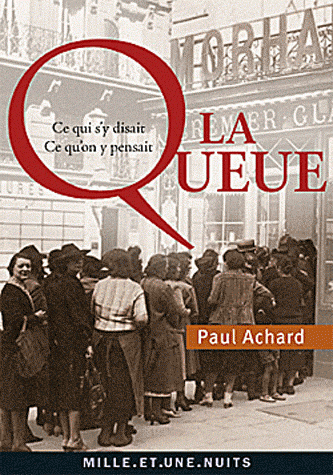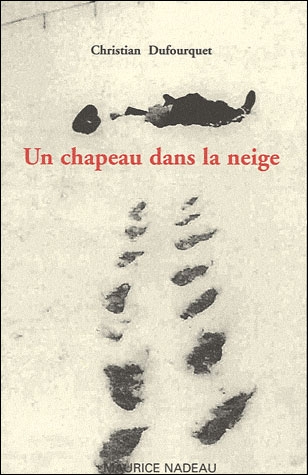Romain Sarnel
En cinq déclics et autant de périodes, le philosophe Romain Sarnel balaie les contresens qui brouillent la lecture de Nietzsche à partir des traductions qui sont livrées à notre connaissance. L’auteur d’une nouvelle lecture du Prologue de Zoroastre (L’Arche Éditeur, 2000) poursuit son entreprise d’éclaircissement dans un Comprendre Nietzsche qui est à première vue un guide mais plus encore une loupe pour se défaire des notions que l’on croyait exactes (« volonté de puissance », « éternel retour du même », « surhomme »…) et qui se révèlent être des montages organisés par la sœur de Nietzsche, Elisabeth Förster, et son ancien ami Peter Gast, contrefaçons reprises sans discernement par Heidegger, Michel Foucault et Gilles Deleuze. Voici donc une révolution sémantique permettant de découvrir un autre penseur, en somme irrévélé, dont les enjeux introduisent l’énergie de la joie et de la créativité au centre d’un système résolument perspectiviste. L’ouvrage prend place dans une collection intitulée Essai Graphique, mettant ainsi en correspondance la vitaminique réflexion de Romain Sarnel avec des dessins de Naema Bellart. Dès lors Nietzsche devient visible et enfin lisible.
Guy Darol : Votre Prologue de Zoroastre, suivi de Logique de la découverte philosophique (L'Arche Éditeur, 2000), lançait une bombe dans la connaissance que nous avons, en langue française, des textes de Nietzsche. À la manière de Jacques Aubert qui initia, quatre ans plus tard, une nouvelle traduction de l'Ulysse de James Joyce, vous avez inauguré une nouvelle lecture des concepts nietzschéens en rapport avec notre époque. Ce message a-t-il été reçu et estimez-vous que le combat mérite de se poursuivre ?
Romain Sarnel : En l'année 2000, j'ai proposé une nouvelle lecture de l'œuvre de Nietzsche à partir d'une nouvelle traduction. Le message n'a pas été entendu. Les nietzschéens et les anti-nietzschéens ont continué à utiliser la vieille terminologie du début du XXe siècle, et se sont déchirés sur la dépouille d'un Nietzsche qui n'existe pas. Nietzsche n'est pas compris parce qu'il est lu avec les lunettes de sa sœur nationaliste Elisabeth Förster qui a confectionné un pseudo-livre intitulé La Volonté de puissance que Nietzsche n'a pas écrit comme tel, et avec le regard du professeur national-socialiste Martin Heidegger qui a diffusé auprès de ses étudiants les pseudo-concepts de « Volonté de puissance » et d'« Éternel Retour du Même » que Nietzsche n'a pas conçus comme tels. Pratiquement, tous les mots traduits de Nietzsche sont faussés dans un sens négatif ou faussés dans le sens d'une idéologie contraire à sa pensée. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé en 1999 dans l'entreprise d'une retraduction de toutes les notions importantes de Nietzsche. Chaque traduction a fait l'objet d'une découverte. Pour cela, je suis allé de découverte en découverte. J'ai retraduit la « volonté de puissance » par le désir vers la potentialité, l'« éternel retour » par le revenir perpétuel, l'« inversion de toutes les valeurs » par la réversibilité de toute valeur, le « surhomme » par le métahomme. Et j'ai retraduit, comme bipolarité du Prologue, le « déclin » par l'immersion et le « passage » par le surpassement. De plus, j'ai retraduit le nom Zarathoustra par le nom Zoroastre pour indiquer que Nietzsche fait référence au penseur perse historique et au zoroastrisme. Avec le livre Ecce homo, remanié, Elisabeth Förster-Nietzsche impose le concept d'« éternel retour », accolé à la philosophie de son frère. Et avec le livre La Volonté de puissance, fabriqué de toutes pièces, elle impose le concept de « volonté de puissance », en le montant en épingle, alors que Friedrich Nietzsche avait trouvé d'autres pistes de recherche, comme par exemple le « perspectivisme ». Ces deux concepts de « volonté de puissance » et d'« éternel retour », relayés par Heidegger, sont arrivés en France pour illustrer faussement la philosophie de Nietzsche. Après, les philosophes français ont dû se positionner par rapport à ces deux concepts, qui sont devenus illusoirement incontournables. Face à la falsification national-socialiste d'Elisabeth Förster et de Martin Heidegger, je pense qu'il faut s'en écarter radicalement. Même Deleuze, qui a tenté d'apporter un regard différent sur Nietzsche, s'est enlisé dans ces deux notions. Il a conclu le colloque Nietzsche à Royaumont en 1964 par l'intitulé « Conclusions sur la volonté de puissance et l'éternel retour ». Ces deux notions, la « volonté de puissance » et l'« éternel retour », n'apparaissent que très peu dans l'œuvre publiée de Nietzsche. La première, la « volonté de puissance », émerge dans Ainsi parla Zoroastre, elle est formée d'un double emprunt, la « volonté » est empruntée à Schopenhauer chez qui elle signifie un désir de vivre, et la « puissance » est empruntée à Spinoza chez qui elle veut dire une potentialité d'agir ; c'est la raison pour laquelle j'ai traduit cette notion par le désir vers la potentialité. Et la seconde, l'« éternel retour », se trouve dans Ecce homo, elle est empruntée à Héraclite et aux stoïciens chez qui elle correspond à un revenir des énergies de façon cyclique ; c'est pourquoi je l'ai traduite par le revenir perpétuel. La notion de « volonté de puissance », ou plus exactement de « désir vers la potentialité », est très peu reprise dans la suite de l'œuvre publiée. Et la notion d'« éternel retour », ou plus justement de « revenir perpétuel », n'est même pas mentionnée dans l'œuvre publiée du vivant de Nietzsche. Aujourd'hui, j'en arrive à penser que le terme d'« éternel retour » a été introduit dans le livre Ecce homo par la sœur de Nietzsche, Elisabeth Förster. En effet, ce livre n'a été publié qu'en 1908, après le décès de Nietzsche ; et, alors qu'il était prêt à la publication en 1888, dans l'entretemps il a été fortement élagué, mutilé, manipulé, falsifié par Elisabeth Förster-Nietzsche et par Peter Gast, l'ancien ami de Nietzsche qu'elle a mis à contribution et qui en a retiré des passages. Du fait que la falsification national-socialiste d'Elisabeth Förster et de Martin Heidegger porte sur le langage et donc sur la pensée, une retraduction du langage de Nietzsche et une redécouverte de sa pensée sont nécessaires pour avoir accès à son œuvre. Cette retraduction du langage et cette redécouverte de la pensée sont des conditions sine qua non de lecture, avant toute analyse, tout commentaire et toute interprétation. Tant que nous n'aurons pas une traduction non national-socialiste, toute analyse de l'œuvre de Nietzsche sera faussée d'avance.
Lire la suite de cet entretien sur Le Salon Littéraire
Romain Sarnel et Naema Bellart, Comprendre Nietzsche, Max Milo, décembre 2013, 127 pages, 12 €