C’est depuis ce bus à plate-forme que je voyais Paris. Un Paris en noir et blanc. À l’arrière du 96, je humais le parfum de tous les échappements, des odeurs de charbon et d’huile de moteur. Nous avions embarqué au croisement hésitant qui distingue la rue de Ménilmontant et la rue Oberkampf. Probablement avec quelques sacs. Peut-être la grosse valise marron toujours sanglée. Et nous regardions défiler les rues, les enseignes. Je ne savais pas que l’heure avait sonné de fuir. Nous quittions la rue du Pressoir que les boules de fonte ne tarderaient pas à attaquer.
 Je découvrais des façades inconnues et des trottoirs étrangement vides. Il fallut descendre. L’arrêt indiquait Place des Vosges.
Je découvrais des façades inconnues et des trottoirs étrangement vides. Il fallut descendre. L’arrêt indiquait Place des Vosges.
J’ai regardé à gauche, à droite et nous l’avons suivi, son allure plus vive qu’à l’habitude. Rue du Foin, il nous signala un bâtiment crème, imposant, couché entre les rues des Minimes et Roger-Verlomme.
- C’est là qu’on habite maintenant.
Sur le trottoir d’en face, pour mieux contempler sa splendeur, nous nous étions serrés. Et mon cœur avait pris un tempo rapide. C’était là. Si propre. Trop beau.
- Régina viendra vivre avec nous ?
- Non, Petounet. Mais Maurice n’est pas loin. Son atelier est rue des Tournelles, tout à côté. On ira le saluer un de ces quatre.
Régina, Maurice, lueurs de la petite enfance. Leurs bras étaient toujours ouverts. Régina me fit découvrir la télévision. C’était le seul meuble qu’elle possédait avec son lit, très vaste. Très doux. On assistait aux aventures d’Ivanhoe couchés dessus. Maurice, son petit ami flou, m’offrait ses nouvelles créations : des casquettes pour petites têtes.
La porte du 7 pouvait atteindre trois mètres de haut. Un drapeau tricolore flottait à son sommet. Lorsqu’on entra, le battant grinça majestueusement. On s’essuya les pieds sur un immense tapis. Deux marches blanches accédaient à un hall de marbre. Papa tourna une clé dans une porte vitrée. On pénétra une pièce vide qui sentait le bois neuf et la peinture fraîche. L’appartement donnait sur la rue, au rez-de-chaussée. C’est là, entre l’étroit et l’infini, que ma jeunesse se débobinerait en un bref clin d’œil.
Je me retourne vite pour en apercevoir quelques images. Il n’en restera plus bientôt qu’un petit tas de poussières poussé par un balai.
Longtemps nous n’avions que le 96 pour aller d’un point à l’autre de Paris. Comme en cabriolet, cheveux au vent, les années où l’on pouvait se tenir à l’arrière, debout, même affreusement serrés. L’air de la ville, le long de la décennie soixante, dégageait un parfum d’amitié.
Le 96 menait à Montparnasse où l’on pouvait embarquer vers les rivages de l’Atlantique. Ou bien il agrippait Ménilmontant, offrant à perte de vue le paysage le plus aimable qui soit.
Le 96, je l’attrapais pour aller rejoindre papa qui travaillait place de l’Hôtel de Ville, plus exactement, avenue Victoria. Nous allions ensuite explorer les sous-sols du BHV.
Le 96, c’était le bus dominical qui ralliait la Porte des Lilas. Car mon père finit par acheter une Dauphine et il loua un box (aux Lilas !) comme un étui de velours où camoufler son jouet. La voiture tournait chaque fin de semaine après avoir été lavée, aspirée, mignotée. Quelquefois, elle servait à nous conduire au pays de la Brie, dans un verger à la ressemblance de nos courtis bretons. En août, à partir du 15 et jusqu’au 15 septembre, la Dauphine noire mettait sept heures pour atteindre La Ville Jéhan, Ménéac, Morbihan.
Le dimanche, le 96 était un paquebot. Il allait plus lentement qu’en semaine. À bord, nous devenions touristes. Et moi je chantais. C’en était même pénible. Je chantais. Je chantais toujours et souvent juché sur les banquettes de moleskine. Mais quoi ? Les succès d’Eddie Constantine ou de Petula Clark.
Dans mon souvenir, le 96 dessert des embarcadères, des cinémas, des passerelles pour voyager dans le temps sans contraintes.
Mais que vous évoque-t-il ?
Je suis certain que vous en avez franchi la marche.
Et qu’une de ses stations vous parle.
D’un instant, d’un parcours, d’un visage qu’il me plairait de connaître. Car nous nous sommes croisés.
Et vous le savez bien. Guy Darol

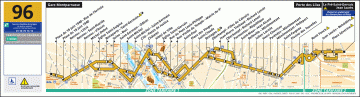
Commentaires
Les quartiers que décrit Guy Darol à travers son évocation de voyages en bus, je ne les ai pas connus dans mon enfance, du temps que les plateformes arrières de ces engins se trouvaient être dans une position de "claire-voie" : moi je suis né comme lui sauf erreur en 1954 mais dans ce que Louis Aragon nommait "Les Beaux Quartiers", à savoir la nappitude Neuilly-Auteuil-Passy : j'ai vécu les dix-huit premières années de ma vie à Auteuil, et près de chez moi c'était le bus 24, sauf erreur, qui m'emmenait vers la Place de l'Etoile via le Trocadéro. Ou bien le 72 qui filait le long de la Seine vers le parisien Hôtel de Ville : c'est là-bas que j'ai certainement du croiser le petit Guy tenant la main de son père et se dirigeant au BHV voisin. Mes souvenirs sont tout aussi pittoresques mais connotés franchement bourgeoisie spacieuse : mes premiers émois esthétiques puis quelques années plus tard érotiques sont liés à la composition vestimentaire de mes voisinnes d'autobus : jeunes filles ou femmes vétues de jupes bleu marine, de chemisiers blancs, de carrés hermès, de bandeaux de velours vert dans les cheveux et de mocassins ou escarpins vernis : toute une symphonie féminine en uniforme (car les bourgeoises des beaux quartiers portent toutes l'uniforme qu'elles achètent pour la plupart chez Franck et Fils, rue de Passy), une symphonie à la fois rafraîchissante et retenue. Le bus c'est l'endroit où l'on regarde ses voisins tout en faisant croire qu'on a concentré son attention sur le spectacle des rues traversées : un bel exercice d'hypocrisie mais une hypocrisie qui repose sur le charme de voir sans être vu et non sur la perversion de duper autrui : tout le monde y est hypocrite et ainsi personne ne l'est. Il y avait également quelques beaux specimens de vieillards à rosettes de la Légion d'Horreur vétu comme des Lords et portant Weston aux harpions, le paquet de religieuses au chocolat négligemment porté par un index qui avait du souvent caresser les comptes bancaires. Tout cela était fendard mais je le dis : j'aurais bien mieux aimer vivre dans une famille différente que la mienne : je ne faisais pas partie de ce monde-là et le vilain petit canard que j'étais se gorgeait de la poésie des rues et des bus pour tromper son ennui. Car c'est cela la bourgeoisie pour un gosse : l'antichambre d'un pesant ennui.
Bravo à Guy pour cette idée de ballades dans les mots via les bus parisiens !