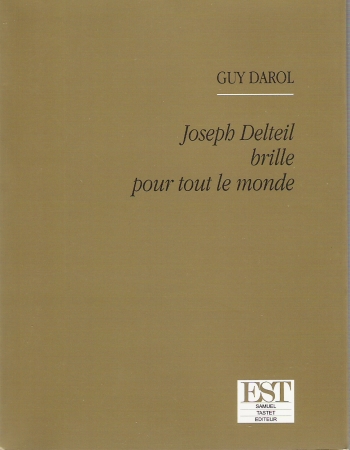En mars 2005 paraissait dans un numéro hors-série du magazine Ecrire & Editer cet entretien emmené par Michel Champendal, camaro de très longue date. Libraire, revuiste, journaliste, animateur d’ateliers d’écriture et éditeur, Michel Champendal est l’auteur d’un bref ouvrage au titre bien évocateur : A Guy Darol, en souvenir du futur. Ce recueil de mélanges témoigne d’un vif enthousiasme pour mes livres biocritiques.
MC : Novembre 2003 – mars 2005 : un laps de temps de près d’un an et demi s’est passé depuis votre entretien avec Ecrire & Editer. Que s’est-il passé de marquant dans votre vie d’écrivain pendant tous ces mois évoqués ? Qu’avez-vous pratiqué ?
GD : La parution, en 2003, de Frank Zappa ou l’Amérique en déshabillé (éditions Le Castor Astral) marque la fin d’un cycle. Mes relations avec le compositeur sont anciennes. J’ai raconté les commencements dans La Parade de l’Homme-Wazoo (Le Castor Astral, 1996). Je ne savais pas alors que Zappa serait un moteur déterminant dans ma réflexion sur la mixité des pratiques signifiantes. Zappa est en effet la clé qui ouvre toutes les portes. On ne peut véritablement entrer dans son œuvre si l’on isole l’espace musical de l’art, du littéraire, du philosophique et du politique. Ce troisième et dernier volume est celui de la combinaison de tous les savoirs, de toutes les intuitions. Il est aussi l’occasion de rappeler que l’œuvre monumentale du compositeur californien est une charge contre l’ignorance. Il me plaît au fond que cet homme dérange et qu’il suscite à la seule évocation de son nom la sympathie ou le dégoût. La sortie de ce livre coïncidait avec le souvenir de sa disparition dix ans plus tôt. Je fus alors souvent contacté pour tenir le crachoir. Et je ne me suis guère privé de l’occasion pour amplifier le point de vue de Zappa contre la militarisation du monde, le glissement des pratiques musicales vers les replis boursiers de l’industrie phonographique. En ces temps où le religieusement correct condamne à mort*, la voix de Zappa (dont fit écho celle de Salman Rushdie) est une assise. Le mardi 2 décembre 2003 au Carré Magique de Lannion, je lui rendais hommage en remuant l’auditoire au moyen d’une rhétorique qui insistait moins sur la virtuosité du guitariste que sur sa clairvoyance dans un domaine qui est celui du retour du Dieu guerrier.
Est-ce que votre activité de journaliste dans des gazettes musicales constitue pour vous matière à construire une œuvre (les articles publiés) au même titre que vos romans, vos nouvelles, vos poèmes ou vos essais ?
Le journalisme qui fut ma première école (celle de l’Agenc e France Presse où j’ai exercé dans les années 1970) est une passion. Ce fut, je crois, mon université avec celle de la rue et des chemins creux. J’y ai rencontré des personnalités qui frémissaient de mieux connaître la réalité : la réalité du terrain, celle que la Sorbonne était bien incapable de m’enseigner. J’ai ainsi rejoint le quotidien Libération avec un entrain rapidement modéré. L’esbroufe, l’appétit de régner étant incompatibles, selon moi, avec la condition de celui qui observe et témoigne. Il fallait alors se battre pour faire passer l’idée que l’important n’est pas dans le stuc mais dessous. J’ai toujours éprouvé de l’estime pour les seconds couteaux, les misfits et ce journal l’a très bien compris qui me fit jouer un rôle de figurant. Je fus longtemps préposé à l’underground ce qui finit par me coûter ma place lorsque Daniel Rondeau, prenant les rênes des pages Livres, décida que l’underground était over. Après un long séjour au Magazine Littéraire qu’emmenait anarchistement (ceci sous mon calame est un compliment) l’illuminé buveur-fumeur-moqueur Jean-Jacques Brochier, j’ai décidé de dire stop à toute activité au sein de la Presse cannibale. Je renonçai aux colonnes (disons Vendôme) qui donnent la préférence au besoin d’exister plutôt qu’à l’urgence d’être. Déception car je croyais (mais sans doute avec la foi du Facteur Cheval) en l’absolue liberté d’écrire soudée, dans ma tête, à l’exemple d’Albert Camus. Je découvrais qu’il fallait d’abord étre-des-leurs avant de pouvoir, comme on dit, s’exprimer. Etre-des-leurs, c’est-à-dire dans le ton, dans le move. Trendy. Point de singularités. Dur pour un canard podagre. Etais-je grillé ? En partie, mais pas sur tout le corps. Ceux qui se doutaient (ayant lu les ouvrages de Greil Marcus) que le journalisme peut être une situation où l’actualité croise le fer avec la culture, ceux-là ont observé ma manière, peu orthodoxe cela va sans dire. Et c’est ainsi que j’ai repris du service, menant bataille en faveur de l’alternatif, de l’inconsensuel, du no commercial potential dans des mensuels spécialisés (Recording, Muziq) que mes chroniques déspécialisent. Enfin, je fais de mon mieux… Parce que oui, dear Michel Champendal, le journalisme n’est pas séparé de la littérature. Il la fomente. Il la nourrit. Ceux qui comprennent Patrice Delbourg, Antoine Blondin, Henri Calet, René Fallet (courez dare-dare acheter ses Chroniques littéraires du Canard enchaîné éditées par Les Belles Lettres), Alexandre Vialatte, apprécieront.
Vous écrivez et publiez depuis une trentaine d’années : au début de votre activité d’écrivain, vous étiez un jeune homme, vous avez dirigé la revue Dérive, une revue de recherche littéraire. Est-ce la démarche que vous recommanderiez à une jeune ou un jeune écrivain aujourd’hui pour commencer à écrire ?
Incontestablement. J’imagine cependant que la mise en œuvre de nos jours d’un projet papier (avec les problèmes de diffusion que cela implique) doit être un sévère casse-tête. La revue est un espace de confrontations. Un échangisme de la pensée où l’enthousiasme, l’indignation, la curiosité cherchent à atteindre le plus haut niveau. Il est important de se confronter, de frotter sa pratique aux exigences de l’autre. Comment avancer, sinon ? Seul ? Dans un vis-à-vis avec le miroir ? Soyons sérieux, les dynamiques de la pensée et de l’art ont toujours résulté de la méthode groupusculaire. Des Hydropathes aux Situationnistes, l’épopée subversive des pratiques signifiantes est marquée par la bande, la jam, le posse ou le crew. Que cela donne lieu à des fanzines, des webzines ou des blogs, l’aventure des formes est une affaire de camaraderie. Alors si tu te sens l’envie de déplacer une cloison, un mur, d’ébrécher une convention, de mettre en pièces un tabou, compose l’espace de ton insurrection. La toute dernière (et première) urgence est de mettre fin à l’isolement pour que la littérature puisse de nouveau donner du coude et frapper du poing.
Les conditions de publication des œuvres pour un écrivain sont-elles plus difficiles ou plus faciles en 2005 que du temps de vos débuts, savoir le commencement des années 1970 ?
Je suis de l’espèce qui, dans les années 1970, méprisait l’édition marchande. Il ne me venait pas à l’idée (sauf à capituler) d’adresser un texte au triptyque Gallimard-Grasset-Seuil. Je me serais déshonoré. Parce que je n’étais pas dupe du mic-mac, des combinaisons aristocratiques, des jeux de pouvoir comme l’on disait alors. Je ne suis pas sûr qu’en 2005 cette éthique soit compréhensible. De toute façon, la difficulté pour un jeune écrivain aujourd’hui c’est de faire connaître son travail. Jamais l’entre soi tyle="color: #000000;">, les petits arrangements, l’aide sous condition d’aide n’avaient atteint ce sommet mafieux. L’écrivain doit avant tout adopter le ton de l’époque, autrement dit la musique du jackpot. Pouah ! Aujourd’hui égale sincérité feinte, exposition du faux à forte odeur écologique, présentation de la surface au détriment du fond. Mais est-ce ta tasse de thé ?
On a coutume de dire que les parcours des auteurs et des écrivains ressortissent de la vie d’artiste et que les débordements narcissiques y sont monnaie courante. Partagez-vous cette opinion ? Ou bien, au contraire, pensez-vous que l’on puisse être un bon écrivain sans plonger sa vie dans un romantisme échevelé qui puisse constituer un enfer pour les proches ?
J’affirme que la littérature est une affaire de vision. On ne peut écrire sans poser sur le monde un regard qui le conteste. On ne peut employer la plupart de son temps sans être convaincu qu’il y a quelque chose à ajouter, une parade, un dernier mot. Il est inutile de s’engager sur cette voie si l’on ne possède la certitude de pouvoir briser une ligne droite. Cela ne signifie pas que l’on pulvérisera les burnes de son entourage, que l’on mettra à plat ses amitiés et ses amours, qu’il faudra tout détruire pourvu que l’on ait raison. La littérature n’est pas un saccage. On peut fonctionner en harmonie dans son univers affectif tout en grippant la machine qui jette sur le flanc la plupart d’entre nous. Se battre, c’est viser la cible.
Vous venez hélas de perdre votre coéquipier dans la rédaction d’un dictionnaire commun sur les vie et œuvre de Frank Zappa. Quelle est la différence notable entre écrire seul et écrire à deux ? A quoi engage le fait d’écrire à deux ? Quels sont les avantages et les inconvénients du travail en duo ?
La mort de Dominique Jeunot au moment où nous envisagions d’améliorer notre Zappa de Z à A relève de l’immonde qui justifie l’insubordination. Dominique Jeunot était un savant foutraque et désordonné. Ce n’était pas tous les jours faciles de travailler en duo. Il fallait, en somme, répéter. Avec ce que le mot répétition implique en fécondité de réussite et d’échec. Nous ne cherchions pas, en concevant ce dictionnaire, à unifier le ton. Chacun s’y trouve et l’on retrouve, me semble-t-il, nos approches particulières de l’œuvre. Ce qui me reste à l’esprit, c’est le pléthorique enthousiasme. Ce livre nous l’avons écrit alors que Dominique habitait Paris et que je vivais en Bretagne. Imaginez : affluence de mails, de courriers terrestres, d’appels téléphoniques. La distance nous rapprochait. Elle a favorisé l’échange. C’est un paradoxe intéressant.
Vous continuez d’habiter en Bretagne, près de Morlaix, en Finistère. Avant l’apparition du Net dans nos vies, c’est-à-dire au début des années 1990, il semblait patent qu’il n’était bon bec que de Paris pour un écrivain, qu’il valait mieux habiter la capitale française pour pouvoir figurer dans les catalogues d’éditeurs résidant si possible rive gauche. Cet état de fait est désormais périmé. En quoi l’internet a-t-il dopé vos rapports avec les éditeurs de livres set de revues, avec les collègues écrivains, avec les critiques et pensez-vous que l’on peut écrire et éditer efficacement si l’on réside en région ? Les éditeurs situés en région bénéficient-ils à vos yeux désormais d’une réputaion égale à celle de leurs confrères parisiens ?
D’abord, il importe de dire que j’ai fui Paris au sens où Joseph Deteil a quitté ce monde « pour un monde meilleur ». J’ai tourné le dos à Parouart parce que me manquait l’odeur des chemins creux, celle de mon enfance parfumée d’ajoncs. Je n’en pouvais plus des factices attitudes, du semblant que l’amour de la littérature m’a appris à combattre. Et puis, lors de mes incursions (j’ai pratiqué l’effort) dans le beau monde on m’a tant fait humer que je sentais le fumier qu’il paraissait logique que je revienne à mes veaux, vaches, cochons. Peut-on dire pour autant que la Bretagne exhale cela ? Ce serait faire plaisir à une certaine nomenclature qui se pense d’élite. Ce serait lui faire croire qu’elle est le centre du monde nouveau. Elle n’est en fait que le nombril du business, celui des tractations qui n’intéressent pas vraiment le lecteur d’André Hardellet que je suis. Internet, en effet, autorise des rapprochements inattendus, des tutoiements, des alliances rapides. Il est désormais possible d’élever des barricades sans remplir de formulaire. Il n’est plus nécessaire d’itinérer par le cocktail avant de se proposer d’en découdre avec le mensonge. La vérité est immédiate. Elle parle au travers d’un mail. Le Net est une boîte à outils qui se rapproche de l’arsenal. Jusqu’où pourra-t-on s’y époumoner ? Quant à l’édition régionale, elle n’est mirifique que lorsqu’elle broute du terrain à Paris. Or, elle n’est souvent que régionale, autrement dit identitaire et subséquemment ethnoïde. Et ça, pour franchement parler, ça me broute.
Comment voyez-vous pour vous puis pour les auteurs l’année 2005 qui se présente ? Les concentrations industrielles et financières de l’édition au sein de grands groupes dont le cœur du métier d’origine n’est pas l’édition constituent-elles des périls pour les auteurs et les petits éditeurs ? Ou bien existe-t-il de la place pour un artisanat talentueux dans l’édition et la grosse cavalerie industrielle servirait-elle alors de locomotive stimulante ? Aurez-vous encore l’opportunité de publier vos textes comme avant ou bien y a-t-il péril en la demeure ?
J’ai passé l’âge où l’on se soucie de faire vivre ses écrits. Si cela fut, ce n’est plus guère mon obsession. J’ai la chance qu’un éditeur, Le Castor Astral, se soit porté garant dès le début de mes exercices littéraires. Il m’est fidèle et cela mérite d’être signalé. Il est certain, par ailleurs, que la solidité de ma frêle entreprise repose entièrement sur l’existence de ce Castor sans cesse bâtissant. Je voudrais somme toute que Jean-Yves Reuzeau, Marc Torralba et Bénédicte Perot soient immortels. Il est facile de comprendre, en effet, que leur disparition ne sera pas remplacée. Car je dois vous dire, Michel Champendal, que la vie littéraire (ou ce qui la parodie) telle qu’elle s’ébroue aujourd’hui m’inquiète. Ces deux mots me semblent en effet artificiellement unis. Pire : ils sont vides de sens. Vie (mais quelle vie ?) et littéraire (où ça ?) me paraissent associés pour le pire. Mais ne soyons pas trop tristes. J’ai foi dans les logiques rebelles, la force de vie justement et l’amour de l’art. Je me dis que ça va chier, que le schproum est en marche, que la jeunesse va nous remettre tout ça d’aplomb. Qu’elle balaie l’imposteur, qu’elle fasse fuir les fainéants de l’exigence, qu’elle relève la littérature vers ces cimes où l’air est bon ! Ecrire c’est vivre, non ?
(*) Pour avoir mis en scène une pièce (Behzti) évoquant un viol dans un temple Gurdwara, la dramaturge d’origine britannique Gurpreet Kaur Bhatti est condamnée à mort par des groupes extrémistes de la communauté sikhe. Mauvais souvenir, pas vrai ?