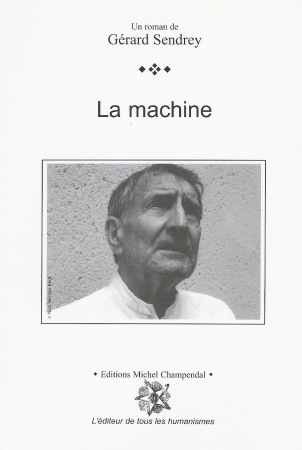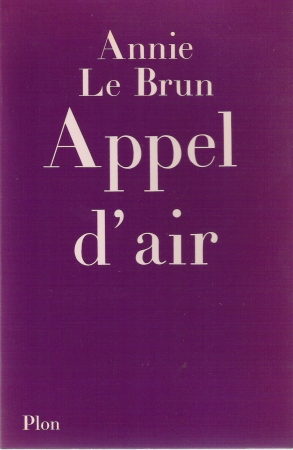Au moment où le Musée de la Poste, célèbre l’universel Gaston Chaissac, il est de toute première urgence de connaître Gérard Sendrey, artiste outsider (et c’est ici le plus haut compliment que je puisse envoyer), poète buissonnier et, depuis peu, romancier unique.
Je serais presque tenté d’écrire romancier hunique (selon l’expression de Jean-Pierre Faye) au sujet d’un livre absolument exceptionnel qui prouve, par son caractère neuf, que la littérature n’est pas en voie de décomposition.
La Machine est un roman comme il s’en écrit depuis Raymond Roussel. Son écriture en est savante (non savantasse !) et savoureuse. Gérard Sendrey n’aurait envisagé d’écrire pour faire comme. Ou pareil. Ou déjà. Il lui fallait une supplémentaire excitation. Un supplément de joie. Toute destinée au lecteur, évidemment.
Mais de quoi s’agit-il ?
La Machine est un lipogramme où les verbes être et avoir sont systématiquement écartés. On se souvient que Georges Perec initia dans La Disparition cette stratégie d’écriture. Mais l’on devine que la suppression de ces deux verbes (avec ce qu’ils comportent de physique, métaphysique, ontologique et économique) va plus loin que le jeu de cache-cache. Ces deux mots pèsent lourd dans la trajectoire de nos vies sursitaires. Ainsi, si Gérard Sendrey fait la chasse à ces deux vocables, c’est surtout pour nous parler de l’essentiel.
L’exercice oulipien n’est pas la fin qui justifie son premier roman. Gérard Sendrey est né en 1928. Ce n’est pas un âge pour faire le con. Du moins pas totalement.
Ce roman parle de l’intérieur de soi pour atteindre le lecteur. Touchant. Touché !
Et je vois en cette machine une machination artiste, un moyen-magie pour faire reculer la mort en restaurant, une fois pour toute, le pouvoir de l’enfance.
Assez d’enfantillages (mot d’ordre sociétal), soyez sérieux, mondialisez vos énergies, rendez vous utiles aux vainqueurs… autant d’impératifs catégoriques lancés par les puissants couillons. La Machine de Gérard Sendrey est un instrument de guerre, une arme sans linéaments, invisible/lisible qui pulvérise les illusions que ciblait Guy Debord. Avez-vous observé, au passage, la haine organisée contre ce nom depuis qu’il est notoire et vaste ? On aimait Debord du temps de sa clandestinité forcée. On le déteste à présent qu’il est sorti au jour (par les fossoyeurs !).
Gérard Sendrey appartient au monde de la Création Franche, celui des formes d’art parallèle aux officiels standards. Ses œuvres plasticiennes foisonnent all over the world et particulièrement dans la Neuve Collection de l’Art Brut à Lausanne. C’est un fabuleux, un créateur de vie. Et un écrivain qui transforme toute tourbe en or pour les oreilles et pour les yeux.
Car La Machine se lit comme un roman (à haute voix, c’est mieux !) au-delà du divertissement. Nous n’en livrerons pas l’intrigue. Sachez qu’elle est ancrée au port des songes de haut verbe où baignent Robert Louis Stevenson (pour qui le fond est dans la forme) et Louis Calaferte.
Gérard Sendrey (du grec aisthétés : qui sent, qui perçoit par les sens) promet une suite à ce grand livre. L’Analyse paraîtra prochainement. Guy Darol
☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟
LA MACHINE
Gérard Sendrey
Editions Michel Champendal