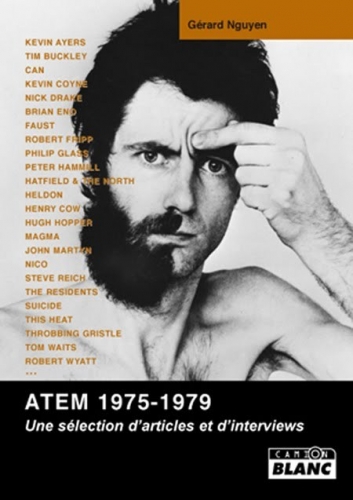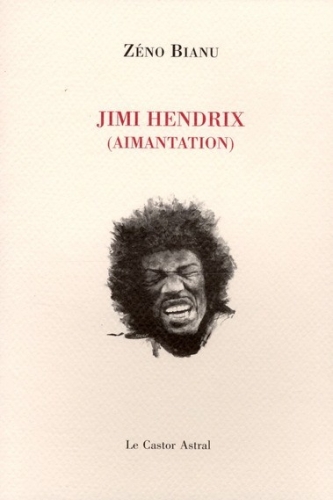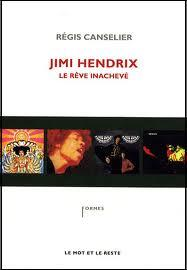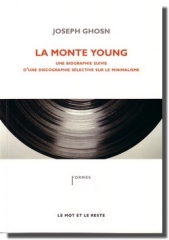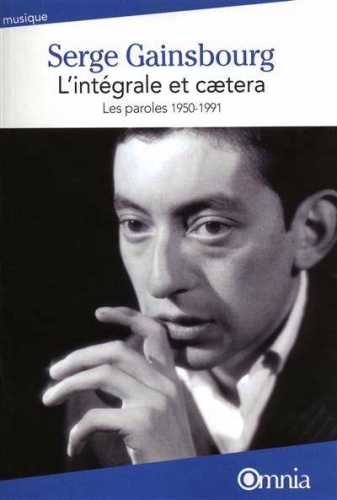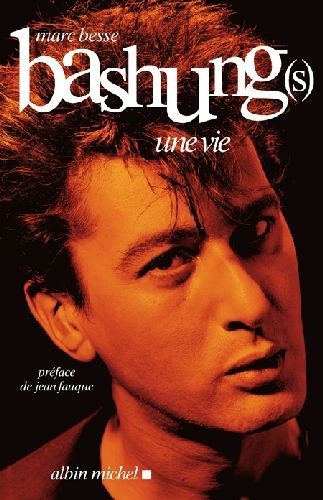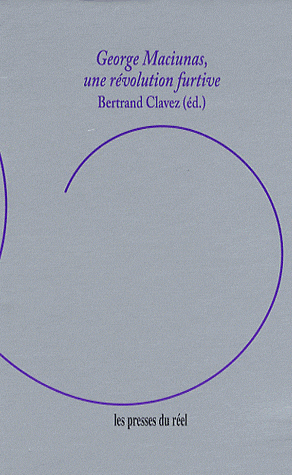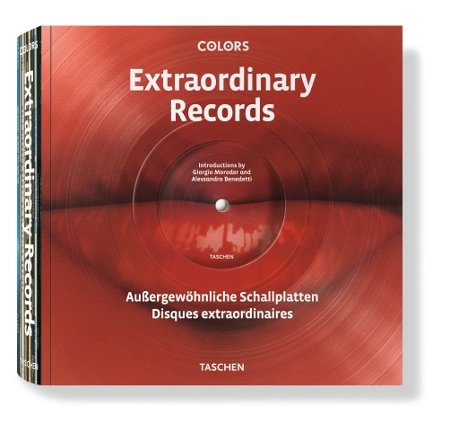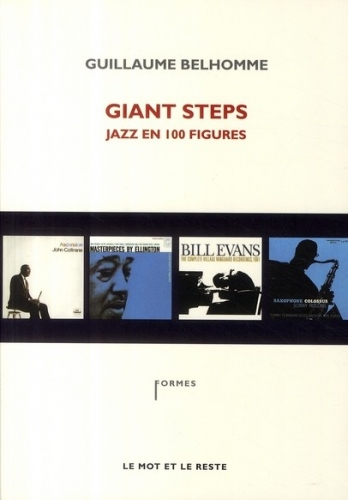Entre 2009 et 2012, Lire la musique, ma chronique (transverse) fut publiée dans Le Magazine des Livres aujourd'hui disparu. En voici le feuilleton complet.
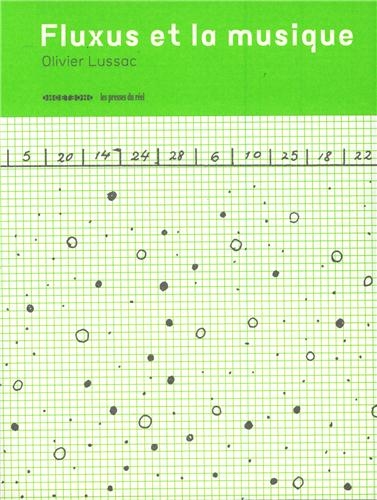
FILET D’EAU ET CASCADES DE VOIX
Un livre qui détaille les relations entre Fluxus et la musique manquait à notre curiosité. Les Presses du Réel ont entendu ma réclamation. Il faut dire que dans ce domaine, elles ne font pas dans la demi-démesure, offrant aux amateurs d’art-nihilisme le catalogue le plus fourni. Olivier Lussac, professeur et chercheur, a trouvé tout ce qu’il fallait trouver pour que Fluxus, né en 1962, sous l’impulsion de George Maciunas, soit finalement reconnu comme l’une des bases de l’avant-garde musicale, à la suite de Dada et des théories bruitistes de Luigi Russolo. Une phrase extraite du Fluxus manifesto de 1966 en dit long sur le projet global : « Fluxus est la fusion de Spike Jones, des gags, des jeux, du vaudeville, de Cage et de Duchamp ». L’humour anime ce mouvement qui met de l’ambiance dans les spécialités en faisant coulisser les cloisons. Et c’est ainsi que la poésie se met à respirer au contact des arts visuels. Le théâtre est secoué par le happening. L’art est dépassé par la vie. Fin des antagonismes. Tout est désormais « beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie ».
Marcel Duchamp est la flèche à suivre et bien sûr John Cage pour qui la musique est dans tous les sons. Un tic-tac de montre vaut un battement cardiaque dès lors que l’art rejoint le temps de la vie. Inutile de dire que l’ouvrage d’Olivier Lussac propose de grandes pages sur Yoko Ono et Nam June Paik, Allan Kaprow (créateur du happening) et Ben (Vautier). Fluxus est contre l’art professionnel et, à ce titre, il élargit son courant à l’absence d’implication, au hasard, à la simplicité. D’où l’évidence que l’eau est un excellent vecteur musical. Il suffit pour Tomas Schmit de placer des seaux ou des bouteilles au bon endroit ou de capter, avec George Brecht, un goutte à goutte. Dans Water Talk, Yoko Ono raconte que « nous sommes tous de l’eau dans différents conteneurs, parfois nous nous évaporons ensemble ». Tel est Fluxus et l’on s’en gargarise jusqu’à plus soif.

Il y a des voix d’eau et des miracles incarnés. Voici Kathleen Ferrier (1912-1953), contralto météorique doté d’une arrière-gorge exceptionnelle, selon Roy Henderson, son professeur de chant. Interprète d’un répertoire tragique (Mahler, Schumann) et cependant le plus joyeux des êtres, Kathleen Ferrier chanta sans rien connaître des mécanismes de la voix, fumant quand elle avait envie. Boris Terk, orthodontiste et traducteur de la biographie consacrée à « la plus grave des voix de femme » (Klever Kaff, Ian Jack, Éditions Allia, 2001), analyse le mystère. Il écoute la voix, le spectre acoustique, le timbre riche en harmoniques. Il ausculte Kathleen Ferrier comme on suit un filon jusqu’à l’or du chant. Il y trouve « un passage de la voix de poitrine à la voix de tête pratiquement imperceptible ». Il parle de voix comme on parle de la vie. C’est simple et passionnant. C’est complexe et intelligent. Le défi inavoué de Boris Terk est de reconstituer Katleen Ferrier selon la méthode de l’écoute amoureuse. Il a gagné.

Dans cette chronique, il me peine de ne pas assez promouvoir la musique en actes, celle qui s’exprime à travers l’artefact CD, lequel s’épanouit dans les bacs des disquaires, car le disquaire existe, dois-je le rappeler. Le disquaire n’est pas mort, et c’est pour ça que doit vivre le duo Arlt (un clin d’œil à Roberto Arlt, répudiateur de la grande littérature et de ses "grands écrivains"), alternative à la chanson réaliste plan-plan (sans le moindre rapport avec Fréhel, Damia ou Jane Chacun) qui nous fatigue les oreilles. Arlt vient de moins loin, c’est-à-dire d’aujourd’hui avec des résonances médiévales et la musique folk psychédélique (voire antifolk pour causer dans l’air qui pue du temps), avec Moondog et Red Crayola, Luc Dietrich et Valère Novarina. Je sais, c’est étonnant mais La Langue, disque de Arlt, doit autant à la littérature (y compris invisible : Louis Watt Owen, Noël Tuot) qu’à René Clémencic et Ivor Cutler. Pour une fois que la musique de ce temps marie la chanson (soit le texte en abyme de tout ce qui fut écrit) et la voie libertaire, l’air et la vraie vie, quelque chose comme Serge Gainsbourg (époque Gainsbourg Confidentiel, 1963) et Pascal Comelade, je devais m’exclamer. Avec Arlt, la voix est sauve, la musique est meilleure. Guy Darol
FLUXUS ET LA MUSIQUE, Olivier Lussac, Éditions Les Presses du Réel, 332 p., 22 €
A VOICE IS A PERSON, Boris Terk, Éditions Allia, 80 p., 6,10 €
LA LANGUE, Arlt, Almost Musique, almost-musique.com.