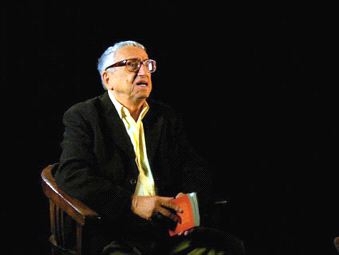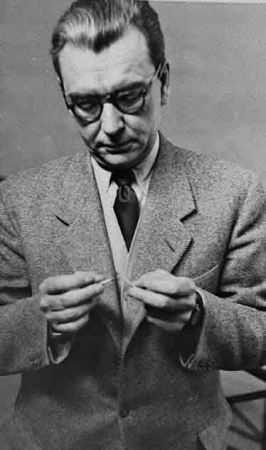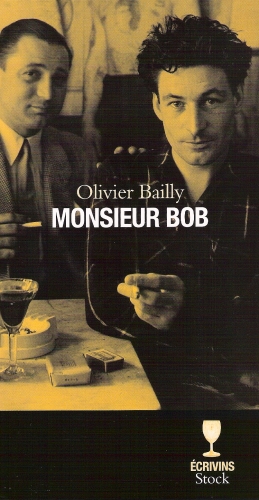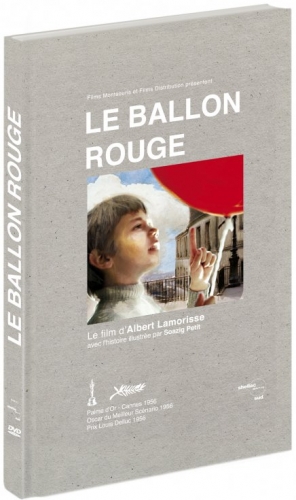23-25, rue du Pressoir
Voici le 23-25 de la rue du Pressoir (vingtième arrondissement de Paris) par où j'allais et venais, chaque jour, à partir de 1954, année de ma naissance. C’est mon pays, le pays natal. Avec son peuple, plus ou moins oublié. L’immeuble fut détruit (le quartier dans sa globalité) et ses habitants sans que l’on se soucie vraiment de l’effet produit par le choc d’une boule de fonte sur l’esprit d’un être, trop petit être sans doute, insignifiant le croyaient-ils.
Je fus l’un de ceux obligés de fuir. Il le fallait. Vers nulle part. Exode en temps de paix. Nous devions quitter le pays. Un pays sans frontières, avec ses cœurs multicolores, ses ethnies, ses croyances si peu pesantes. Nous vivions sur un même palier, portes ouvertes.
Cette locution on la pratique de nos jours, comme un jeu de mots. Portes ouvertes n’était pas, à la fin des années cinquante, une attitude, un challenge. On vivait ainsi, les uns avec les autres. Y compris, les uns chez les autres. C’était la vie, n’est-ce pas ?
Je me doutais qu’en jetant une boutanche à la mer me reviendrait un oiseau. Je savais, un jour ou l’autre, qu’un ange agiterait ses ailes. Je viens de vivre ce moment de grâce. Comme si tout espoir était permis. Une leçon, non ?
Je viens de connaître la grâce (subversive) qui bouscule le train-train du mensonge. Avec Josette Fariboul, ma voisine du 25 de la rue du Pressoir, la vérité se fortifie. Il fallait, somme toute, liquider le brouillage des couleurs. Il fallait unifier. Le couple De Gaulle/Malraux n’avait d’autre objet que la réalité d’un Paris unifié. Pas de couleurs ! Rien que que les vibrations chromatiques d’un peuple arraché à son abattoir. Mes parents venaient (expulsés tout comme) de Bretagne.
Josette Farigoul a lu mon billet sur la rue du Pressoir. Elle y a vécu. Elle témoigne :
« J'ai lu que vous habitiez au 25 rue du Pressoir, moi aussi j'habitais au 25 de cette rue, que de souvenirs en lisant votre article. J'ai d'ailleurs le livre de Willy Ronis et de Clément Lépidis mais effectivement personne ne parle de notre rue du Pressoir. Je suis née au 25 en 1948 et j'y suis restée jusqu'à l'expulsion en 1966. Vous parlez du café chez Andrée, c'est dans ce café que j'ai rencontré mon mari en juillet 1965. L'épicerie de Madame Gilles, sa boutique était rouge, j'y allais tous les jours, elle nous faisait crédit. A cette époque la vie n'était pas facile. Il y avait aussi le coiffeur Vincent, le garage MARCHADIER, je crois. Dans la cour, le matelassier. J'aimais bien le regarder travailler. Passage Deschamps, la mère fouillis et au coin, le café chez FREDO. Notre concierge NICOLE. Au mois de novembre j'ai retrouvé une amie d'enfance, par l'intermédiaire de Copains d'avant, elle habitait passage du Pressoir, dans la diagonale du 25. Nous allions ensemble à l'école rue Etienne Dolet. Nous nous envoyons des mails depuis. Elle possèderait une photo du 25 rue du Pressoir et du garage. Elle va me la faire parvenir. Quel dommage de ne pas avoir de photos de notre rue. J'ai bien essayé de chercher mais je ne trouve pas. Je suis toujours en relation avec mes amis d'enfance de la rue du Pressoir. Nous sommes toujours présents pour les bons et les mauvais moments. Nous organisons des repas de temps en temps et à tous les coups nos conversations partent en délire sur la rue du Pressoir. Nous nous remémorons toutes ces bêtises d'adolescent que nous avons fait.
Que de beaux souvenirs que je n'ai jamais oubliés.
Je vous adresse mes sincères salutations.
Josette FARIGOUL
♠
Cher Guy,
Merci pour votre réponse qui m'a bouleversée, principalement lorsque vous parlez de votre mère. J'ai, à ce moment- là, pensé à mes parents qui sont partis bien trop tôt. Je dois vous avouer que j'ai pleuré devant mon ordinateur en lisant votre message.
Il est certain que nous nous sommes croisés et que je connaissais, probablement, vos parents. Je connaissais tout le monde, j'ai très souvent fait des courses pour beaucoup de personnes, je gagnais quelques petites pièces pour acheter un pain, surtout en fin de mois. Mes parents avaient pas mal de problèmes.
Je ne sais pas si vous vous souvenez que de temps en temps nous retrouvions, devant nos portes, des échantillons de lessive, savonnette Bébé Cadum, café etc... Votre mère s'en rappellera certainement. Et bien, si comme beaucoup de locataires elle ne trouvait rien devant sa porte, je peux bien l'avouer 50 ans après, c'est que j'étais passée par là en faisant tous les étages dans le noir. Pas de quoi en être fière.
Donc vous, vous habitiez dans l'escalier face à la porte d'entrée. Moi, j'étais dans la cour, au 3ème étage, il n'y avait que trois étages de ce côté là. Logiquement vous étiez au 23 et moi au 25. J'étais souvent assise au bas de votre escalier, nous n'avions pas le droit de jouer dans la cour. J'étais aussi, souvent, dehors devant la porte. C'est pourquoi je dis que nous nous sommes déjà vus et même vos parents car nous devions dire bonjour à tous les locataires que nous croisions. A cette époque, c'était bonjour Monsieur ou bonjour Madame mais jamais un simple bonjour en passant.
Je me rappelle de petits garçons jouant aux billes devant le garage. Moi je jouais aux osselets ou aux cartes.
Vous avez peut-être connu les jumeaux qui étaient plus de votre âge (1955) et qui habitaient un peu plus haut au dessus de chez Vincent, le coiffeur, après le café chez Andrée. Les jumeaux jouaient souvent dans le caniveau lorsque l'eau coulait, pieds nus en sandales, même en hiver. Ils s'appelaient Christian et Michel Choutier. Michel est décédé, bien trop jeune, en 1997. Christian, je le vois toujours avec ses soeurs qui sont mes amies d'enfance.
Comme dit mon fils, nous, nous n'aurons jamais de tels souvenirs ni cette nostalgie que vous avez de votre quartier. Effectivement, comme vous le dites si bien, notre enfance a été sévèrement maltraitée du fait de cette destruction. "Ils ont cassé le berceau de mon enfance", quelle belle phrase de Jo Privat ! Je crois que nous pensons tous la même chose.
Dans le livre de Clément Lépidis, Je me souviens du 20e arrondissement, à la page 79, photo rue de la Mare, en arrière plan, nous voyons une femme avec son cabas et deux enfants. Cette femme est la mère de cette amie que j'ai retrouvée au mois de novembre, les deux enfants, cette amie Claudie et sa soeur. Claudie m'avait dit "regarde bien, dans son sac on voit une bouteille". Elle connaissait bien sa mère. A cette époque, malheureusement, l'alcool était présent dans beaucoup de familles. La pauvreté aussi mais sans jamais se plaindre.
Je pensais que de votre côté il y avait 5 étages mais dans ce cas, si il y avait eu 5 étages, comment de la fenêtre de ma chambre au 3ème étage et bien sûr lumière éteinte, aurais-je pu voir les Baert, de votre côté au dernier étage à droite au fond du couloir, se battre pour à la fin se réconcilier en s'embrassant. J'en rigole encore car c'était très souvent et la bagarre se terminait toujours de la même manière. J'avais 13 ou 14 ans lorsque je les épiais et j'attendais le dénouement.
Je crois qu'elle habitait au 1er toujours de votre côté, on l'appelait la Chinoise, mais il me semble qu'elle n'était pas Chinoise, c'était son mari qui était Chinois, elle m'envoyait acheter des sangsues, si je me souviens bien, chez l'herboriste, rue des Couronnes.
Au rez-de-chaussée, sur la photo du 25 on voit leur fenêtre, là habitaient les Dilouya. Sur cette même photo, la fenêtre au dessus du garage, c'était chez Cocotte, pourquoi on l'appelait Cocotte, je ne sais pas. Il faisait de la couture, un Juif qui avait bien failli être arrêté pendant la guerre. Juste avant l'arrivée des Allemands, il s'était caché sur la terrasse du garage. C'était tellement le merdier sur cette terrasse qu'il n'avait pas eu de mal pour se cacher. Maman était à sa fenêtre, elle avait vu Cocotte se cacher et tout de suite, après, les Allemands arriver. Ce pauvre Cocotte était connu du quartier car il avait tellement été traumatisé que, certaines nuits, il entrait en crise, se mettait à hurler pensant que les Allemands revenaient, il clouait des planches à sa fenêtre pour les empêcher de rentrer chez lui. Le lendemain matin on voyait notre Cocotte déclouer les planches. Tout était rentré dans l'ordre jusqu'à la prochaine fois. Maman m'avait raconté son histoire car ses cris en pleine nuit faisaient peur et je ne comprenais pas pourquoi il clouait des planches à sa fenêtre, la nuit, pour les enlever le lendemain. Il nous aimait bien mes soeurs et moi, il nous offrait souvent des bonbons, certainement par reconnaissance, sans jamais avoir reparlé de cette histoire ni lui ni ma mère.
Il y a eu de sacrées histoires dans nos immeubles. Mais que de beaux souvenirs.
L'endroit qui me faisait peur c'était cette espèce de couloir entre l'escalier et la loge de concierge, un couloir très sombre qui me permettait d'aller chez Madame Gilles lorsque la boutique était fermée. Je n'aimais pas passer par là.
Sans parler, de mon côté, dans la cour, celui du rez-de-chaussée qui en se suicidant au gaz aurait pu faire sauter l'immeuble. Madame Paulette qui sur la cinquantaine, peut-être plus, exerçait, encore, le plus vieux métier du monde, comme elle rentrait vers 2 ou 3 heures du matin, elle m'appelait pratiquement tous les jours pour faire ses courses. Une fois par semaine je lui achetais Intimité et Akim. Des souvenirs et des noms qui restent ancrés dans ma mémoire et pourtant j'avais 10 ou 12 ans.
Mon nom de jeune fille est IDOUX, nous étions 4 filles. Les 4 filles du père Idoux comme certains locataires disaient.
Même si la vie n'était pas facile pour tout le monde quelle belle époque. J'ai dans la tête plein de souvenirs du temps où j'ai vécu Rue du Pressoir. Après l'expulsion plus rien n'était pareil. Ma mère qui chantait tout le temps et commençait à 6 heures du matin n'a plus jamais chanté lorsque nous sommes arrivés vers la porte de Bagnolet. Tout était cassé.
Vous trouverez aussi une photo de la boutique de Madame Gilles et la façade de l'immeuble qui vous rappellera quelque chose, je pense. Par contre quand nous voyons l'immeuble en construction, notre rue n'a plus rien à voir avec ce que nous avons connu.
Amicalement et un grand bonjour à votre maman.
Josette
♣
Cher Guy,
C'est encore avec beaucoup d'émotions que je lis votre réponse, pour un petit garçon si jeune, je trouve que vous vous rappelez de beaucoup de choses. Vous en parlez si bien, les mots sont très beaux, c'est aussi votre métier. Moi je n'ai qu'un certificat d'études car il fallait travailler très jeune pour aider nos parents. Les épreuves nous font grandir. J'ai beaucoup de souvenirs en mémoire car la vie était très dure. Durant 20 ans, je n'ai pu écouter la chanson de Daniel Guichard "Mon vieux" chanson pourtant que j'adore ainsi que Daniel Guichard, mais j'ai dû attendre 1991 ou 1992 pour aller le voir à l'Olympia. J'ai malgré tout pris sur moi lorsqu'il l'a chantée. Depuis, les rares fois où il passe à Paris ou a Rouen, puisque j'habite dans l'Eure, près de Rouen, je vais le voir.
Cette chanson me rappelle trop mon père sauf qu'il n'avait pas un vieux pardessus râpé mais un veston et sa musette avec sa bouteille, mais chut !!! qu'il n'a pas pris le même autobus de banlieue mais le métro à Couronnes. Certainement qu'avant de prendre son métro il s'arrêtait "Aux lauriers roses" et tout au long de cette chanson, je le reconnais.
Effectivement vous étiez certainement cet enfant qui jouait dans le caniveau devant le garage. Les mamans aimaient bien surveiller leurs enfants de leur fenêtre. Je devais jouer la comédie pour pouvoir jouer devant la porte comme je disais car de la cour, maman ne pouvait pas me surveiller.
Je vais demander à mon amie que je viens de retrouver 48 ans après et qui elle habitait passage du Pressoir, si elle se rappelle d'une dame qui gardait des enfants.
Oh oui, que ce couloir et cet escalier étaient sombres. De mon côté il y avait une fenêtre à chaque palier mais une cave qui faisait très peur. J'arrive encore à rêver de cette cave et de la cour.
Certainement que cette Régina, je la connaissais aussi, malheureusement je ne me souviens pas des noms.
Il est vrai que la télévision c'était magique. Nous avons eu la télé, j'avais 12 ans, donc en 1960, en fin d'après-midi si je me rappelle bien, lorsque l'image apparut c'était Rintintin. Super !
On était, malgré tout, souvent seuls. Les parents ne laissaient pas, effectivement "traîner" leurs enfants. Je me suis rattrapée, un peu, vers mes 15 ans.
En regardant le fil de ma vie, je me dis que j'ai toujours travaillé, au début pour aider mes parents, par la suite avec mon mari, qui avait une entreprise d'ascenseurs et qui est parti, bien trop tôt, en 1993, tué par le stress, d'un infarctus, en quelques minutes. Puis après, avec mon fils, ils ont tous compté sur moi, et moi je vis quand ? Je crois surtout que j'ai la vie que j'ai choisie.
Comme vous le dites si bien, à la fin, en parlant du 23/25 "un pays en somme". Exactement, moi je dis toujours : nous sommes comme les pieds noirs, nous avons la nostalgie de notre pays.
Comme beaucoup de personnes ayant vécues dans ce quartier, nous avons tous un point commun "la nostalgie de ces belles années"
Et bien, après toutes ces évocations, je vais pouvoir me mettre au travail.
Bien amicalement,
Josette
VISITER NOTRE SITE ENTIEREMENT CONSACRE A LA RUE DU PRESSOIR :
http://ruedupressoir.hautetfort.com/

 Joseph Bialot (comme Maurice Fourré, vous connaissez ?) a débuté en littérature après cinquante ans. Dès lors, il avait tout à dire et je crois qu’il a eu raison de se retenir pendant plus d’un demi siècle. Sa bibliographie compte une vingtaine de livres. À vrai dire, je ne l’aurais sans doute jamais lu sans le conseil mirobolifique de Christophe Daniel, mon libraire. Il vit et travaille à Morlaix (Finistère) et nous avons beaucoup à échanger sur Paris, vingtième arrondissement. Comme moi, il y a ses racines.
Joseph Bialot (comme Maurice Fourré, vous connaissez ?) a débuté en littérature après cinquante ans. Dès lors, il avait tout à dire et je crois qu’il a eu raison de se retenir pendant plus d’un demi siècle. Sa bibliographie compte une vingtaine de livres. À vrai dire, je ne l’aurais sans doute jamais lu sans le conseil mirobolifique de Christophe Daniel, mon libraire. Il vit et travaille à Morlaix (Finistère) et nous avons beaucoup à échanger sur Paris, vingtième arrondissement. Comme moi, il y a ses racines. Le livre s’intitule Belleville Blues et ceux qui suivent ici mes dérives parisiennes ont compris que ce titre va à mes préférences. Joseph Bialot se souvient de son arrivée, presque triomphale, boulevard de Belleville, après un voyage de deux nuits et un jour dans l’express Varsovie-Paris. Voici donc un récit d’immigré. Qui évoque un quartier disparu, des falaises d’immeubles aujourd’hui effondrées. Nous sommes en 1930. Il rappelle, par exemple, qu’au sommet de la rue Oberkampf, là où s’arrête le 96, il attendait le bus au front duquel paradait la lettre Q. Joseph Bialot se remémore la plaisanterie qui courait alors. Le jeu « consistait à demander à un passant choisi au hasard : « Pardon, m’sieur, savez-vous où se trouve l’arrêt du « Q » ? » C’est ainsi que l’on riait au temps que la musique retentissait au Boléro, à la Java, et que sortir au cinéma (le Templia, le Cocorico, le Floréal, le Phénix, l’Impérator) durait toute une après-midi.
Le livre s’intitule Belleville Blues et ceux qui suivent ici mes dérives parisiennes ont compris que ce titre va à mes préférences. Joseph Bialot se souvient de son arrivée, presque triomphale, boulevard de Belleville, après un voyage de deux nuits et un jour dans l’express Varsovie-Paris. Voici donc un récit d’immigré. Qui évoque un quartier disparu, des falaises d’immeubles aujourd’hui effondrées. Nous sommes en 1930. Il rappelle, par exemple, qu’au sommet de la rue Oberkampf, là où s’arrête le 96, il attendait le bus au front duquel paradait la lettre Q. Joseph Bialot se remémore la plaisanterie qui courait alors. Le jeu « consistait à demander à un passant choisi au hasard : « Pardon, m’sieur, savez-vous où se trouve l’arrêt du « Q » ? » C’est ainsi que l’on riait au temps que la musique retentissait au Boléro, à la Java, et que sortir au cinéma (le Templia, le Cocorico, le Floréal, le Phénix, l’Impérator) durait toute une après-midi.