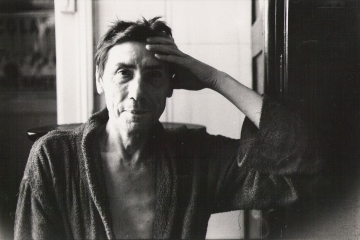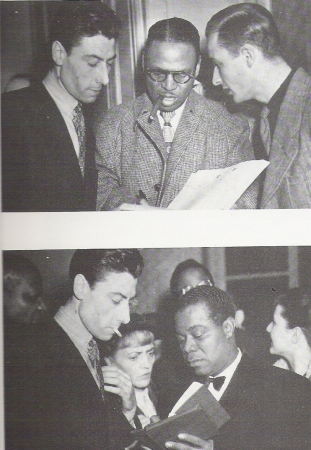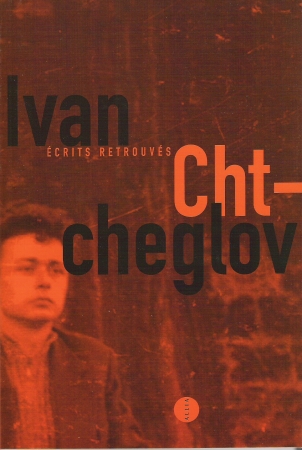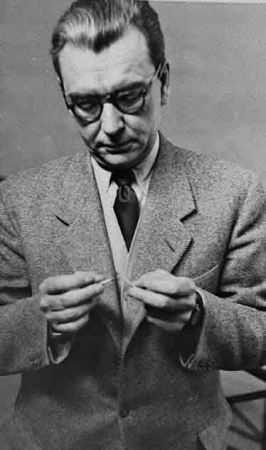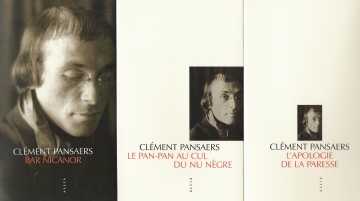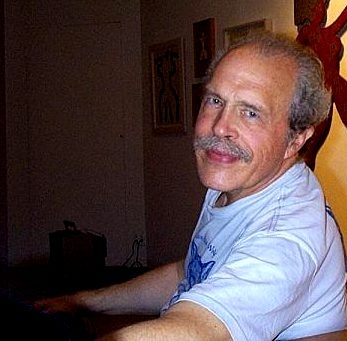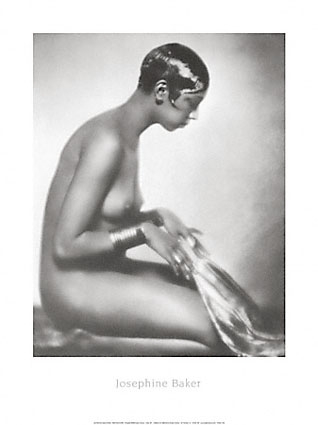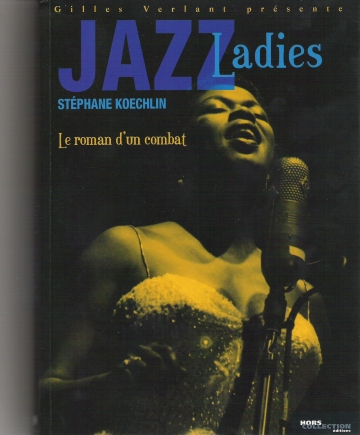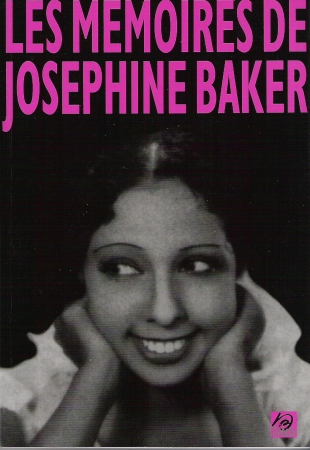Romancier, critique, poète, bibliophile, essayiste, librettiste, nouvelliste… Charles Monselet (1825-1888) fut tout cela, points de suspension compris. « Polygraphe aux accents éclairés », selon Sylvain Goudemare, cet écrivain se fit connaître par des pastiches, des parodies (Dumas, Sue) et définitivement remarquer grâce à une préface aux Mémoires d’Outre Tombe de Chateaubriand. Chroniqueur au Figaro, à l’Événement, au Journal du Matin, au Pays, au Monde Illustré, il apparaît comme une « vedette du journalisme » et est vite apprécié de ses contemporains : Sainte-Beuve, Hugo, Tellier, Barbey d’Aurevilly. Sa Lorgnette Littéraire (1857) est un témoignage exceptionnel sur les littérateurs du XIXe siècle. Il s’y attache de « petits » auteurs (Defontenay, Scholl) tout de même qu’il y défend Pétrus Borel et Xavier Forneret, alors que ce dernier est moqué de tout le monde.
Admirateur d’Hugo et de Nodier, et avec eux du romantisme, Charles Monselet est autant un propagandiste de talents connus ou obscurs qu’il est un écrivain méritoire, assez génial dans ses études cocasses et satiriques, particulièrement lorsqu’il soigne le portrait des plumissieux. Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages dans lesquels il mélange tous les genres, il est capable de trousser avec un égal bonheur poésies et recettes de cuisine.
Chroniqueur de la Revue des Gastronomes et du Gourmet, il a créé de délicieux sonnets dont une « Ode au Cochon » qui le déconsidéra auprès de Jules Laforgue alors qu’il espérait se faire élire à l’Académie Française.
Subtilement et joyeusement annoté par Sylvain Goudemare, Le Plaisir et l’amour permet d’accéder à un très étonnant volume qui réunissait quelques figures du XVIIIe siècle passés dans l’ombre. Les Oubliés et les Dédaignés, paru en 1857, réhabilite en effet des auteurs dont, sauf exception de Rétif de la Bretonne, le succès n’a jamais retenti. Sylvain Goudemare a choisi de présenter, parmi ces oubliés, le Chevalier de la Morlière, le Cousin Jacques, Louis-Sébastien Mercier, Grimod de la Reynière et Charles Lassailly, ce « petit romantique », plus vaste que l’étiquette qui l’épingle.
Charles Monselet qui, selon Sylvain Goudemare, « préfère la sensation à la pensée », commente l’histoire de ces hommes et de leurs œuvres avec un penchant pour le détail qui donne un trait bien net et de la couleur vive. « Critique impressionniste », il sait aussi pincer et tirer à boulets rouges lorsqu’il évoque l’exploitation de Lassailly par Balzac.
L’auteur des Roueries de Trialph fut en effet élu par Balzac qui collectionnait les secrétaires afin d’ébaucher, voire de grossoyer sa besogne. Enfermé dans sa manufacture à romans, Lassailly était soumis à un travail d’esclave. Attelé à la tâche jour et nuit, aiguillonné contre le sommeil par des platées d’épinards et d’oignons en purée, Trialph, comme le surnommait ses amis, joua la fille de l’air pour mettre fin à ce régime de forçat.
Monselet qui aimait dessiner les êtres, surtout les « infiniment pauvres », se révéla un bon aquarelliste du Paris Montmartrois. Quelques-unes des belles pages du Plaisir et l’amour immortalisent, comme les clichés du photographe Eugène Atget, les aspects aujourd’hui mutilés d’une ville qui appartenait alors aux carriers et aux fabricants de bougies. Guy Darol
☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟
Le Plaisir et l’amour
Anthologie présentée par Sylvain Goudemare
Editions du Griot, 1988
Le Monselet gourmand
Florence Arzel et Maryse Aupiais
Editions Jeanne Lafitte, 1988 ➷
LE COCHON
(Le plaisir et l'amour)
Car tout est bon en toi: chair, graisse, muscle, tripe !
On t'aime galantine, on t'adore boudin
Ton pied, dont une sainte a consacré le type,
Empruntant son arôme au sol périgourdin,
Eût réconcilié Socrate avec Xanthippe.
Ton filet, qu'embellit le cornichon badin,
Forme le déjeuner de l'humble citadin;
Et tu passes avant l'oie au frère Philippe.
Mérites précieux et de tous reconnus !
Morceaux marqués d'avance, innombrables charnus!
Philosophe indolent qui mange ce que l'on mange !
Comme, dans notre orgueil, nous sommes bien venus
A vouloir, n'est-ce pas , te reprocher ta fange ?
*
Le sonnet de l'asperge
Oui, faisons lui fête !
Légume prudent,
C'est la note honnête
D'un festin ardent.
J'aime que sa tête
Croque sous la dent,
Pas trop cependant.
Énorme elle est bête.
Fluette, il lui faut
Plier ce défaut
Au rôle d'adjointe,
Et souffrir, mêlé
Au vert de sa pointe,
L'or de l'œuf brouillé.
☟
Figurines parisiennes par Charles Monselet
PREMIER COUP DE CRAYON
Il en est de Paris comme de l'Océan : les poëtes et les peintres en feront le sujet éternel de leurs toiles et de leurs pages, de leurs croûtes et de leurs chefs-d'oeuvre. Paris est un modèle qui pose pour tout le monde. Les uns le peignent en pied, les autres en buste ; ceux-là en font une académie, ceux-ci une miniature ; il en est qui le montrent de face, de profi l, de trois quarts ; j'en ai rencontré qui se contentaient d'un oeil ou d'un pied, de moins encore.
On me demande d'être vrai. Je le serai ; - à cela près cependant que je ne réponds pas des distractions de mon modèle. Si mon modèle bâille ou fait la grimace, s'il a les yeux rouges ce jour-là, s'il ne se souvient plus aujourd'hui de la pose d'hier, la faute n'en sera jetée que sur lui. - Peut-être adviendra-t-il, par suite, que le Paris de tel chapitre sera tout opposé au Paris de tel autre. Pour cela, que l'on ne crie pas à la contradiction, ou pire encore, au paradoxe. D'ailleurs, Paris m'a tout l'air lui-même d'un paradoxe effréné.
Ceux qui sont venus avant moi ont adopté pour la plupart des formes convenues, un cadre précis. Les timides, les ingénieux, les amusants, et quelquefois aussi les philosophes, se sont déguisés en Persans, en Turcs, en Tartares, en Mogols, en Arméniens, en Japonais, en Chinois et en Cochin-chinois. Dans ce cas, Paris s'appelait Ispahan, Bagdad, Constantinople. Le XVIIIe siècle tout entier s'est longtemps amusé de cette mascarade ; le sévère Montesquieu et le turbulent Diderot se sont tous les deux affublés du turban et de la robe bariolée aux longues manches pendantes : «Que Mahomet vous donne la prudence des lions et la force des serpents !» ont-ils dit à M. Jourdain, le bourgeois de Paris. - Ensuite est arrivée la mode des spectateurs, des observateurs, des ermites. Quelques écrivains privilégiés ont rencontré des fées, des génies, des ombres illustres qui se sont fait un véritable plaisir de leur servir de cicerone et de leur fournir la clef des charades de la rue et des logogriphes du salon. De plus humbles se sont contentés d'un petit vieillard ou d'une petite vieille, centenaire pour l'habitude, à l'oeil vif, à la voix cassée, au sourire malin, au nez barbouillé de tabac, portier ou marquise, gentilhomme ou femme de chambre, un débris du siècle passé, qui, entre deux accès de toux, crachait une épigramme ou un portrait.
L'HOMME QUI ENGRAISSE LES COMÉDIENS
Je le connais, - et voilà pourquoi je parle de lui. Si je ne l'avais pas vu, je ne voudrais pas croire à son existence. C'est un des originaux les plus incompréhensibles que l'on puisse rencontrer sur le pavé de Paris, où, cependant, se trouvent rassemblés tant d'originaux. Il y a quelques années seulement que s'est révélé l'homme qui engraisse les comédiens. Son visage est insignifiant, sa mise est celle de tout le monde ; il n'a de vraiment singulier que sa grande maigreur. Auprès de lui, Voltaire paraîtrait gras. Cette maigreur a résisté jusqu'à ce jour aux nutritions les plus excessives ; les rosbeefs d'Angleterre et les pâtes d'Italie n'agissent sur lui pas plus que sur un clou.
Ses antécédents sont enveloppés d'un mystère impénétrable. Fût-il marchand de cuirs comme Chicard, fleuriste comme Brididi, professeur de musique comme Carnevale ? A le voir errer tout le jour en oisif, on supposerait qu'il savoure les fruits d'un héritage inespérément éclos sous ses pas. Il se tient d'ordinaire aux environs des théâtres lorsque commencent les répétitions, et le reste du temps dans les cafés fréquentés par les artistes dramatiques, tels que le café de la Gaîté, celui de la Porte-Saint-Martin et l'estaminet des Variétés. D'ailleurs, il ne fume pas, il ne joue pas, il ne lit pas les journaux. - Que fait-il donc ? il guette.
L'homme qui engraisse les comédiens met paisiblement ses mains derrière son dos, il regarde au plafond, il se mouche avec un bruit de trompette ; on n'est pas plus candide. Toutefois, il tourne déjà autour de son homme. Insensiblement, il s'approche de la partie commencée ; si c'est le billard, il est la galerie ; il approuve les coups, il sourit avec entraînement ; vienne un point douteux, il est pris pour arbitre et désormais il a le droit de conseiller. Vous trouveriez difficilement un homme plus poli que lui : il offre de l'absinthe au comédien, et puis encore de l'absinthe ; alors, il s'enhardit à causer, il a vu le comédien dans tous ses rôles, et le comédien lui a paru prodigieux, complet, trente mille fois supérieur à ses confrères. Le comédien gobe modestement cette énorme louange.
Mais l'heure d'une nourriture plus substantielle est arrivée. L'homme qui engraisse les comédiens propose un dîner chez Bonvalet ou au Banquet d'Anacréon.
Ici commence son travail. Dès qu'il tient son comédien à table, il se transfigure. De ses yeux si béats tout à l'heure, se dégagent d'électriques paillettes. Il mange peu, mais il l'incite à manger ; et pour cela, il fait venir des vins extraordinaires, des vins jaunes, qui bruissent sourdement et font les courroucés dans les verres ; il évoque les sauces furieuses de la Provence. Puis, du coin de l'oeil, il observe si le comédien engraisse. Pour lui pousser plus facilement les morceaux, il lui rappelle ses créations les meilleures. - Oh ! que vous étiez magnifique dans Pascal le Ramoneur ! - N'est-ce pas ? Au quatrième acte surtout... - Encore un peu de cette sauce aux crevettes, dit-il subrepticement. - Si le comédien ne mange pas, la louange s'arrête ; elle recommence s'il mange ; elle se fait tour à tour insinuante, emportée ; elle est cordiale, elle s'attendrit ; elle pleurerait presque.
Le comédien engraisse.
Bien entendu que l'homme qui engraisse les comédiens les choisit jeunes et fluets autant que possible. C'est aux jeunes premiers, aux amoureux qu'il s'attaque, à tous ceux pour qui l'embonpoint est un fléau. Et quand une fois il les tient, croyez qu'il ne les lâche plus. Il est le contraire des vampires : il tue par la vie. Dès qu'il a saisi un comédien, ainsi qu'un magnétiseur saisit un sujet, il entre de gré ou de force dans son intimité, il se fait obligeant, puis nécessaire et enfin indispensable. Alors, il faut que le comédien dîne tous les jours avec lui. Sans cela, le comédien serait un monstre d'ingratitude. Il faut que le comédien se laisse traîner successivement chez Véry, chez Leblond, à la Maison dorée ; il faut qu'il mange quand on remplit son assiette, il faut qu'il boive quand on remplit son verre. Il faut que le comédien engraisse, en un mot.
L'homme qui engraisse les comédiens est implacable. Un mois, deux mois au plus lui suffisent pour faire d'un être svelte un mortel à peu près obèse. Il a engraissé déjà cinq comédiens des théâtres du boulevard ; ces malheureux n'ont pas pu réussir à renouveler leur engagement ; le directeur leur a ri, non pas au nez, mais au ventre. Ils sont ruinés aujourd'hui. Il ne leur reste plus qu'à prendre l'emploi des queues rouges ou celui des pères nobles. - Lui, cependant, l'homme qui engraisse les comédiens, continue à rester toujours maigre.
J'ai longtemps cherché le secret de cette monomanie : je suis presque convaincu que cet homme poursuit une vengeance ; j'entends une vengeance collective. Le souvenir de quelque drame intime et amer, expiré derrière une coulisse, doit perpétuellement le tenailler ; c'est sans doute par le théâtre qu'il a souffert, et c'est sur le théâtre qu'il veut se venger. Qui sait si lui-même n'a pas brigué jadis l'emploi de jeune premier, et si sa maigreur révoltante ne l'a pas fait repousser de toutes les scènes ? Dans ce cas, c'est contre toute une cohorte qu'il se rue ; c'est un genre tout entier qu'il tend à faire disparaître de l'art dramatique. Il veut détruire les comédiens par la bonne chère. Mais les comédiens sont prévenus ; j'ai signalé l'homme et je signale le danger.
J'espère que cela suffira pour déjouer les menées ténébreuses de l'homme qui engraisse les comédiens.
L'ABOYEUR DE SÉRAPHIN
Il y a quelques années, l'aboyeur du Théâtre-Séraphin n'était pas ce jeune homme que l'on voit tous les soirs sous les arcades du Palais-Royal, annonçant à voix haute et très-intelligible les féeries d'Ali-Baba, ou la sept millième représentation de l'impérissable Pont-Cassé. C'était un vieillard, coiffé d'un chapeau gris et enveloppé d'un carrick contemporain de la Sainte-Alliance ; son dos était voûté, sa voix était enrouée, il rappelait quelques-unes des créations ténébreuses et grimaçantes d'Hoffmann. Tout le monde le connaissait, car depuis plus de vingt ans il remplissait son emploi d'aboyeur et traînait sur les dalles du Palais-Royal les plis de son immuable carrick.
J'ai su l'histoire de cet homme. Il s'appelait M. de Saint-V***, et était le beau-frère d'un des plus spirituels acteurs du Théâtre des Variétés, aujourd'hui éloigné de la rampe. Jadis M. de Saint-V*** avait mené une existence brillante, légère, amoureuse ; à l'époque de la première révolution, c'était un petit-maître accompli, avec un brin d'épée sous la basque et du fard au talon. Un des premiers il avait émigré à Coblentz. Là, on ignore si, à l'instar de plusieurs courtisans, il remua des salades ou s'il donna des leçons de danse pour vivre.
Sous le Directoire, M. de Saint-V*** était déjà bien déchu : il courait la province en compagnie de comédiens et de comédiennes, donnant des représentations partout où il y avait une grange ou une salle municipale ; menant l'existence accidentée et flottante de Desforges, de Pigault-Lebrun, de Plancher-Valcour et de Mayeur de St-Paul ; dînant trop ou ne dînant pas ; usant son coeur en galanteries vulgaires, et voyant chaque jour s'effacer en lui les traces distinctives de sa noblesse et de son éducation.
Lorsque vint l'Empire, il acheta un carrick, - ce même carrick qui a fait notre étonnement et que nous avons froissé tant de fois. Avec ce carrick, il trouva encore le moyen de coqueter pendant quelque temps ; puis enfin de décadence en décadence, il arriva jusque devant la porte du Théâtre-Séraphin, que dirigeait alors François Séraphin, successeur et neveu de Dominique Séraphin, le grand, le fondateur. M. de Saint-V*** possédait de remarquables restes de haute-contre ; on l'engagea, lui et son carrick, en qualité d'aboyeur.
Tristesses de ce monde ! - Pendant plus de vingt ans l'émigré de Coblentz, le muscadin de l'an VII s'est égosillé sur le seuil de ce spectacle de marionnettes et d'ombres. Ombre lui-même, il a rivalisé de haillons avec le cynique Duclos ; il est devenu une des curiosités de ce Palais-Royal où il s'était promené si souvent en cadenettes et en habit vert ; les enfants ont ri de lui comme d'un casse-noisette, - de lui ; vicomte de Saint-V***, qui avait tenu l'emploi des Almaviva à Bordeaux et en autres lieux ! Mais de tout cela il se consolait avec la bouteille.
Quelquefois, il voyait se rendre chez Frascati des femmes qu'il avait connues jadis et qu'il avait aimées ; des femmes aux épaules toutes nues ou toutes couvertes de diamants ; des femmes qu'eût admirées et peintes Gérard ou Guérin. Il les voyait passer sans qu'elles le reconnussent, et il ne s'en émouvait pas davantage, qu'elles s'appelassent Euphrosine ou Aglaée, Aspasie ou Héro. Lui continuait à crier, stoïque et insinuant : - Entrez, messieurs et mesdames, le spectacle va commencer ; vous allez voir la Belle et la Bête, le Voltigeur mécanique et le Magicien Rotomago...
Et puis, comme je viens de le dire, il aimait la bouteille. Avec cela, on devient aisément philosophe, dans le sens banal et poétique attaché à ce mot ; avec cela, on oublie d'abord ses douleurs, et insensiblement on arrive à pardonner à ceux ou à celles qui vous les ont faites. C'est le véritable baume de fier-à-bras dont parle Cervantes dans son roman. Parfois, M. de Saint-V*** passait deux ou trois jours sans paraître à son poste accoutumé ; quand il n'aboyait pas, il buvait. On le rencontrait alors sur les hauteurs de la montagne Sainte-Geneviève, dans quelque cabaret de la rue Clovis ou de la rue de l'Epée-de-Bois, perdu dans un sourire heureux ou endormi dans son carrick.
Sur les derniers temps, ses absences devinrent plus fréquentes. Sa voix s'éteignait aussi, son regard était rentré dans la coulisse, il marchait difficilement. Il arrive un moment où les vieillards, ces représentants d'un autre âge, doivent se trouver bien effarés ou bien accablés du poids du passé qu'ils portent sur leurs épaules. Songer qu'alentour les jeunes gens se disent : - Voilà le dix-huitième siècle ! Et n'avoir, Atlas indigne, que le vêtement troué de M. de Saint-V*** pour cacher sa honte ou draper sa dégradation !
La fin de ce pauvre homme arriva tout à coup, en une enjambée. Un soir qu'il récitait son boniment sur une note plus lugubre et plus basse que de coutume : - l'Oiseau bleu... le Pont-Cassé.... la Chasse aux Canards... - il tomba soudainement. Les passants s'amassèrent autour de lui et voulurent lui prodiguer du secours ; mais tout était inutile : M. de Saint-V*** ne vivait plus.
Dans l'intérieur du Théâtre-Séraphin, on chantait :
Les canards l'ont bien passé,
Tire lire lire, tire lire laire ;
Les canards l'ont bien passé,
Lire lon fa.
IL PLEUT, IL PLEUT....
S'il y a un chapitre à écrire, c'est principalement sur la fange proverbiale des trottoirs parisiens. Après l'eau, l'air et le feu, la boue peut être classée, du moins sur cette partie du globe essentiellement crottée, comme un nouvel élément et prendre place en cette qualité dans les manuels de physique. Comment la boue se produit d'un instant à l'autre, c'est un phénomène, une énigme. Dix minutes d'une pluie volante suffisent pour changer en cloaque le quartier tout à l'heure le plus net et le mieux entretenu. - Mais peu importe au bourgeois de Paris ! au contraire ; le bourgeois va à la pluie comme le fer à l'aimant, le papillon à la chandelle. C'est sa glu, à lui. C'est juste au moment où le ciel se rembrunit, qu'il songe à l'affaire importante qui l'appelle à l'autre quartier de la ville ; et point ne remettrait si belle partie au lendemain. Néanmoins, comme le bourgeois de Paris est un homme prudent et de précautions, il se munit du parapluie, ce roi des meubles ; et le voilà qui se met en route, après avoir déclaré que cette pluie ne serait rien. - Remarquez bien qu'il est persuadé du contraire ; sans cela il ne serait point sorti. - Mais quelle jouissance pour lui et quelle noble conquête de choisir le pavé le plus propre a u milieu de ces pavés engloutis par l'averse ; de disputer aux plus opiniâtres le trottoir du côté des maisons ; de hausser et de baisser alternativement son parapluie selon la taille des passants, tout en risquant de l'accrocher dans les enseignes ou d'éborgner ceux qui sortent des magasins ! Il ferait dix lieues de la sorte, sans s'apercevoir qu'il est trempé jusqu'aux os. De temps en temps, et pour l'acquit de sa conscience, il hèle un omnibus qui l'éclabousse, mais il a bien le soin de ne s'adresser jamais qu'au plus complet. S'il a l'occasion de passer sur la place du Carrousel, il la saisit avec empressement, dût-il même être forcé de faire un détour pour cela. Il peste contre le vent, il maudit les gouttières et les ruisseaux, mais ce n'est pour lui qu'un thème purement de convention. Examinez plutôt l'aimable expression de sa figure, lorsque la violence de la pluie le force à se réfugier sous une porte cochère. - Ah ! messieurs, quel abominable temps ! s'écrie-t-il en saluant avec urbanité. - Vient-il à monter chez un de ses amis, la scène prend alors un aspect plus héroïque ; c'est avec une orgueilleuse satisfaction et un sourire de conquérant qu'il s'entend adresser des reproches sur son imprudence : - comment avez-vous pu vous décider à sortir par une pluie semblable ? C'est de l'entêtement, de la folie ! vous en ferez une maladie, bien certainement ; voyez un peu comme l'eau ruisselle de votre redingote ! - C'est vrai, répond-il, et de mon chapeau aussi. - Ainsi fait le Parisien, cet homme souverainement heureux, qui prend le temps comme Dieu le lui envoie, et qui ne se plaint autrement que pour la forme ; être à demi aquatique qui passe à travers les plus grandes tempêtes, sans en presque rien sentir. - Pour un Parisien qui attrapera un rhume de cerveau à s'être mouillé les pieds une demi-journée, trente Provinciaux gagneront une fluxion de poitrine. Mais le Parisien est une plante qui a souvent besoin d'être arrosée par l'eau du ciel.
COMMENT SE FONT LES VAUDEVILLES
Il y a un vaudevilliste nommé D***, qui est très-mélancolique et qui ne peut trouver les sujets de ses vaudevilles qu'en suivant les enterrements. Enterrement de ses amis ou de ses ennemis, peu lui importe. Il sort de chez lui, il prend des gants blancs, qui lui ont facilité déjà plusieurs situations ; il revêt un habit noir instigateur de couplets, il se met à la queue du convoi et penche la tête d'un air navré. A vrai dire, il serait très-embarrassé de nommer le mort qu'il suit, mais il ne s'en préoccupe que médiocrement ; ce qu'il guette, c'est une idée nouvelle, c'est un dénoûment curieux, une exposition inusitée. Il a déjà fait de la sorte plusieurs pièces d'un fort comique et d'un entrain délicieux. Lorsqu'il trouve un calembour sur le bord d'une fosse, il s'estime l'homme le plus heureux du monde. D*** est d'ailleurs un convive charmant, qui improvise de spirituelles chansons au dessert.
A la première représentation de son dernier vaudeville, il portait au coude gauche un crêpe, - qu'il avait oublié d'arracher.
OU L'ON CULTIVE LES ROSIÈRES
Nanterre est un village coquet, situé entre Colombes et la forêt de Saint-Germain. Les femmes y sont toutes habillées de robes de la couleur des tomates ; on y vend des gâteaux beurrés et l'on y entend, mêlé au son des cornemuses, les pscht, pscht du chemin de fer. L'idylle est traversée par une locomotive.
Ceux de Nanterre, comme on s'exprimait dans le vieux langage, couronnent une rosière tous les ans. Quand nous disons tous les ans, c'est tromperie. Il n'y a pas eu de couronnement en 1848, à cause de la révolution ; mais à présent les choses ont repris leur train ordinaire.
- Bonjour, monsieur le bailli et monsieur le tabellion ; Blaise, va-t'en chercher ton tambourin et faisons danser un peu les jeunesses du pays. Une rosière ! la peste ! quel excellent gibier d'opéra-comique !
La rosière de Nanterre figure d'une façon plaisante au milieu de notre époque. Il y a comme cela deux ou trois coins de terre en France où l'on s'occupe de cultiver la vertu, de même qu'on s'occupe de cultiver les dahlias et d'élever les vers à soie. Tout est procédé aujourd'hui. Seulement le nombre des villages éleveurs s'amoindrit de jour en jour. Nanterre et Salency font bonne contenance encore ; mais leur vertu fait peine à voir, tant elle est laide et piteusement fagotée. C'est de la vertu quand même. Salency surtout, ce bosquet peint par Greuze, - n'est plus maintenant qu'un taudis bas Breton, un repaire de Maritornes. Ses habitants ont le rosièrisme passé dans le sang, et, pour n'avoir point voulu se mêler avec leurs voisins, leurs générations s'en vont petit à petit, crétinisées, bossuées et bancalisées par la vertu.
C'est la comtesse de Genlis, - la petite Georgette, comme on l'appelait, - qui s'est vantée d'avoir découvert les rosières de Salency : «J'avais dix-huit ans. Salency est à quatre lieues de la terre que j'habitais, et j'ignorais jusqu'au nom de ce village, devenu si fameux depuis. Nous jouions la comédie ; l'un de nos principaux acteurs nommé M. de Matigny, était en même temps magistrat de Chauny et bailli de Salency. Un jour que nous voulions le retenir à coucher, pour faire une répétition le lendemain, il nous dit qu'il était obligé d'aller dans un village voisin. - Et pourquoi ? lui demandai-je. - Oh ! répondit-il, pour cette bêtise qu'ils font là tous les ans. - Quelle bêtise ? - Il faut que j'aille, en qualité de juge, entendre pendant quarante-huit heures, tous les verbiages et tous les commérages imaginables. - Et sur quel sujet ? - Il s'agit d'adjuger, non pas une maison, ou un pré, ou un héritage, mais une rose... Alors on ne donnait rien qu'une rose à de pauvres filles qui manquaient souvent de pain. «La curiosité de madame de Genlis eut cela de bon, que M. Lepelletier de Morfontaine, qui l'accompagnait, fonda une rente perpétuelle de deux cents livres pour la rosière de Salency. - A Nanterre, la rente est de trois cents livres.
La rosière de cette année a pour nom mademoiselle P*** ; elle demeure à l'extrémité du village, dans la maison dite Maison des voleurs. Déjà vous me demandez si elle est jolie. Mais comment peut-on être jolie avec des gants de coton blanc, comme la pauvre fille en portait ? Cependant elle a la beauté du diable, si cette expression mal sonnante peut s'appliquer à une vierge. Ne faisons point trop fi de la beauté du diable, et n'allons point quérir un goupillon d'exorcisme ; bien heureux ceux qui la possèdent ! En ces diaboliques temps que nous nous sommes faits, tout nous vient un peu du diable.
La cérémonie a eu lieu dans l'église de Nanterre, auprès du puits miraculeux de sainte Geneviève. Un groupe de petites filles portait la couronne de roses, douillettement posée sur un coussinet de velours. Derrière le tambour, entre le maire et son adjoint, la rosière venait, les yeux bas, rougissante et modestement embarrassée de sa vertu. Elle était accompagnée de la rosière de la dernière année : cela faisait deux rosières. L'église était pleine jusqu'au clocher, où toutes les cloches mises en branle dansaient leur vacarme réjouissant.
Deux monstrueux sapeurs se tenaient, ornés de leur hache affilée et brillante, de chaque côté de l'autel. Au premier aspect, nous n'avons pas bien compris ce rapprochement entre les sapeurs et les rosières. Il y en avait un surtout qui ressemblait comme deux gouttes de sang à un tortionnaire des gravures d'Albrecht Durer. Il a donné le frisson à mademoiselle P*** quand elle a levé les yeux sur lui. A quelque distance de ces hommes on remarquait les anciens du village, avec des noeuds de rubans bleus à l'épaule et des houlettes pavoisées de la même nuance. Puis la famille populeuse de la rosière, pour laquelle des bancs dans le choeur avaient été réservés. Ce tableau naïf et remuant, au milieu duquel poudroyait un rayon de soleil fièrement transversal, donnait frais au coeur comme un bon réveil.
Le soir, la rosière a paru un instant au bal Morel, sur la pelouse, - à quinze pas des blés de Nanterre, où se mélangent si joyeusement pendant deux lieues de chemin le rouge des coquelicots, le bleu des bleuets et le jaune des navettes.
On trouve aussi des rosières au pays de Montesquieu, au château de la Brède, - un joli château, trempant ses pieds dans l'eau comme la sarcelle. - Mais le meilleur pays de production, c'est sans contredit le département de Lot-et-Garonne. Au mois de janvier 1846, je me suis trouvé à l'apothéose des vestales de Tournon, avec Jasmin, le barbier-poëte. Ce jour-là, vingt et une couronnes ont été distribuées par la commission syndicale. Vingt et une rosières d'un seul coup de filet ! - Qu'on vienne parler de Nanterre après cela. - Il est vrai que ces jeunes filles laissaient beaucoup à désirer sous le rapport des grâces, et que la quantité suppléait largement à la qualité. A peine en ai-je remarqué une, une seule, presque enfant, un peu mignonne, tout étonnée, - rosière avec des yeux de Rosine, - et sur le visage de laquelle, comme disait Jasmin en patois, roses et lis étaient escrapoutis.
LE PEINTRE DES MORTS.
Comme la nuit j'ai peur du diable
Et que je cains les revenants,
Je mets la chandelle sur la table
Et je ferme les contrevents. |
Ces vers d'une chanson campagnarde me sont rentrés dans la mémoire un soir de la semaine dernière pendant que l'on causait fantômes et seconde vue chez un de nos collègues. On avait vidé le sac aux effrois et rappelé des choses terribles : les apparitions du boulanger François, les chasses du grand veneur de Henri IV, les fièvres chaudes de Guilbert de Pixérécourt. Chacun de nous, plus ou moins, s'était senti tirer les pieds passé minuit, ou avait vu, - comme je vous vois, - une figure blanche, au pied du lit accoudée.
La conversation, toute frissonnante, s'en allait de la sorte, tour à tour provoquant l'incrédulité ou forçant la foi, lorsque le musicien V*** fut amené à raconter une histoire très-étonnante et très-effrayante, malgré son côté goguenard, ou plutôt à cause précisément de son côté goguenard.
La voici :
- Mon père, dit la musicien, était, comme vous le savez, un peintre intelligent et estimable ; on l'appelait souvent pour peindre les gens après leur mort, triste spécialité dans laquelle il avait réussi à se faire une réputation. Il m'emmenait quelquefois avec lui, pour m'aguerrir, disait-il, mais plutôt, je crois, pour s'aguerrir lui-même, et aussi pour l'aider dans ses funèbres préparatifs.
Ordinairement il faisait la barbe aux défunts, avant de les peindre ; il les cravatait quand c'était des hommes, il leur peignait les cheveux et leur faisait la raie. Aux femmes, il mettait des chapeaux à plumes, des colliers, des gants ; il leur frottait les joues avec de l'esprit de vin pour rappeler les rougeurs évanouies.
Un jour, mon père fut mandé par un riche étranger, un Russe, dont la femme venait de mourir. - Allons, petit, donne-moi ma boîte à couleurs, et viens avec moi. - J'aurais autant aimé rester à jouer du violon, mais je n'avais pas le choix. En sortant, mon père me mit sous le bras un roman qui venait de paraître et qui faisait quelque bruit, le Cocu, par Paul de Kock.
Arrivés à la maison mortuaire, nous trouvâmes le Russe en proie à la plus vive douleur ; il nous conduisit en sanglotant auprès du lit de la morte, et nous eûmes toutes les peines du monde à lui faire comprendre qu'il fallait absolument qu'il se retirât afin que nous puissions travailler. Une fois seuls, mon père disposa la dame, la coiffa d'un bonnet à rubans et lui plaça un bouquet de roses au corsage. Je la vois encore ; c'était une personne imposante et de grande taille ; elle semblait respirer, et de temps en temps se dégageaient de son corps les derniers glouglous de la vie. Mon père me fit asseoir sur le lit, à côté d'elle, et, m'ordonnant de la tenir soulevée sur son séant en l'enlaçant d'un bras, il me dit de lui lire le roman que j'avais apporté.
Je me souviens que la journée était magnifique, et que, par une fenêtre ouverte, il nous arrivait un soleil éblouissant. Mais ce beau temps et les joyeusetés du Cocu, que je lisais sans interruption, ne parvenaient pas à détourner mon esprit de ce cadavre que je serrais contre moi. Il me semblait qu'il y avait dans cette lecture faite à l'oreille d'une morte quelque chose de sacrilége. Je n'étais pas rassuré, et lorsque, après deux heures de séance, je descendis enfin du lit, je crus que mes pieds étaient devenus de marbre. Mon père me plaisanta beaucoup sur ma pâleur, - et il m'enjoignit de faire une corne à l'endroit du roman où nous en étions restés...
Ici le musicien s'arrêta comme quelqu'un qui hésite.
- Est-ce tout ? lui demandai-je.
- Non, répondit-il ; l'histoire a un dénoûment, et ce dénoûment c'est toute l'histoire. Mon père, qui était un esprit fort méritait d'être puni. Il le fut, en effet, mais d'une manière épouvantable, terrifiante. Appelez cela vision ou cauchemar, toutefois est-il que ses cheveux, de gris qu'ils étaient, devinrent blancs au bout d'une semaine. C'est que pendant une semaine, toutes les nuits régulièrement, la princesse russe revint lire à mon père le Cocu, de Paul de Kock.
UNE BIBLIOTHÈQUE DE GRISETTE
Emile Debreaux, qui fut le Gentil-Bernard des grisettes, a fait une chanson intitulée : Ne montez pas chez elles. Dans cette chanson, notée sur l'air de la Catacoua, il décrit le désordre pittoresque de leur ameublement et rit tant qu'il peut des loques éparpillées, des corsets errants, des bas qui sèchent sur des ficelles, des carafes qui implorent les coquilles d'oeufs purificatrices. Il n'oublie qu'un trait : il ne parle pas de la bibliothèque des grisettes, une des choses qui provoquent le plus l'étonnement et l'hilarité.
Cette bibliothèque est une dans toutes les mansardes. Elle se compose invariablement d'Hippolyte, comte de Douglas, de Maria ou l'Enfant de l'infortune, - et d'un Almanach des Amours ou Almanach de la Closerie des Lilas, je ne sais plus lequel, mais il est reconnaissable par un frontispice colorié représentant des étudiants en béret qui portent triomphalement sur leurs bras une grisette, agitant en l'air une queue de billard. Sur le devant, on aperçoit un symbolique Béranger, recourbé par en haut comme une canne, et regardant passer le joyeux cortége avec un sourire - très-mal venu sur la pierre lithographique.
Le même almanach contient presque toujours des fragments poétiques de Privat, tel que l'hymne célèbre où se rencontrent ces deux vers rimés avec une rare fierté :
Le boulevard où l'on coudoie
La jeune fille au long cou d'oie
.
La bibliothèque des grisettes a ses éditeurs particuliers et ses auteurs spéciaux. Parmi les premiers, Renault et Krabbe sont ceux dont le commerce est le plus considérable ; ils font refaire, en falsifiant le titre, les oeuvres à succès que les petits lecteurs n'ont pas les moyens d'acheter ni même de louer. C'est ainsi qu'on peut se procurer chez eux pour six sous l'Histoire du fameux comte de Monte-Cristo et de ses trésors, les Aventures de d'Artagnan et de ses trois compagnons, Mathilde ou l'Innocence d'une jeune femme, les Mystères de la Tour de Nesle, etc., etc.
Je croyais, jusqu'à présent, qu'il n'y avait qu'un seul nom pour désigner ce trafic : contrefaçon. Il paraît que les libraires susdits, en ont trouvé un autre, qui est : réduction.
En dehors de ces réductions, on ne distingue pas un grand nombre de romans inédits, dans le sens absolu du mot. La vogue est toujours aux Amours d'une jeune servante et d'un soldat français. Dans ce genre, Pécatier et Picquenard n'ont pas encore rencontré de rivaux.
N'oublions pas de mentionner, au milieu de cette nomenclature, un minime bouquin, épais et carré, - de la forme d'un pavé vu au petit bout d'une lorgnette, - ayant pour titre : la Goguette de Lilliput, et orné des trois profils de Piron, de Gallet et de Collé. C'est un recueil de vieilles chansons grivoises qui menacent de se perpétuer à travers les siècles, en ramenant toujours le même sourire sur l'air de Turlurette, et le même clignement d'yeux à propos du refrain : Eh bien !... Vous m'entendez bien.
Mais de tous les livres affectionnés par les grisettes, celui que vous êtes le plus certain de rencontrer au fond de la corbeille à ouvrage, à côté du jeu de cartes traditionnel, du dé à coudre et de l'oeuf en bois qui sert à repriser les bas, le livre le plus consulté et partant le plus recroquevillé à ses angles, celui qu'on s'empresse d'ouvrir au saut du lit, lorsqu'on est à jeun, - sur lequel on médite avec délices ou que l'on rejette avec dépit ; le confident, le conseiller, l'écho, c'est le livre intitulé diversement : la Clef des Songes, - l'Oracle des Dames et des Demoiselles, - la Voix du Destin, - l'Urne magique - ou la Sibylle couleur de rose.
C'est en feuilletant un livre semblable, écrit par les farceurs les plus naïfs, qu'on peut se rendre compte, mieux que par la lecture de Senancourt et des romans esthétiques, de tout ce que l'âme d'une femme contient de faiblesse, de crainte, d'illogisme, d'irrésolution et de folies. Une femme qui consulte la Clef des Songes cesse d'être une énigme et un problème ; vous pouvez dès lors la dominer tout à votre aise, avec la certitude que les moyens les plus grossiers seront les meilleurs.
La Clef des Songes ou «interprétation de tous les objets qui peuvent apparaître dans le sommeil, >d'après les plus subtils docteurs du monde», a été, j'en suis assuré, la cause de bien des mariages, de bien des séparations, de bien des suicides. Ce livre cache une importance extraordinaire sous des apparences bénignes. Qui pourrait voir, en effet, des catastrophes sous ces simples lignes, que nous copions :
BARBE. Se la faire : réussite complète ; - à un autre : mauvais présage.
BOUDIN. Affliction ; - en manger : surprise.
GENDARMES. Lumière profitable ; - qui vous arrêtent : travail rémunéré.
OIGNONS frits : lasciveté étonnante.
HUITRE. Ouverte : satisfaction infaillible ; - fermée : embuscades périlleuses.
JOUES potelées : joies ineffables.
La Clef des Songes est quelquefois plus compliquée :
MURAILLES. Devant soi : preuves d'impuissance ; - qu'on surmonte : amélioration ; - avec un fossé : emblême menaçant ; - tomber d'une muraille : plaisir incomparable (oh !).
D'autres fois, elle est littéraire et railleuse :
JOURNAL. En lire un: perte de tranquillité.
NAVET. Esprit improductif et froid. (Cela est évidemment une flatterie à l'adresse de l'auteur des Libres Penseurs).
TRAGÉDIE. En voir jouer : tristesse, pâles couleurs.
Le plus souvent, la Clef des Songes accumule comme à plaisir des impossibilités :
BRAS musculeux : triomphe.
COURONNE. Dignité personnelle ; - si elle est d'os de mort, avec des feuilles de saule : destruction. (Qui diable peut voir en rêve une couronne d'os de mort, et avec des feuilles de saule encore !)
NOMBRIL. Voir son : c'est être dans la bonne voie pour le royaume des cieux.
Ce dernier est le plus étonnant, et nous n'en citerons pas d'autres.
Beaucoup cependant, parmi les femmes qui consultent la Clef des Songes, ont réclamé le droit de monter à la tribune et de faire des lois !
L'Oracle des Dames et des Demoiselles surpasse encore en extravagante puérilité la Clef des Songes : il répond à «toutes les questions sur les événements et les situations diverses de la vie» ; la dernière édition en a été corrigée et augmentée d'après les manuscrits des savants Etteilla, Lavater et Julia Orsini. C'est cet oracle qui, à l'éternelle question : Que fait maintenant la personne à laquelle je pense ? ne manque jamais de répondre : Elle soupire après le jour qui vous réunira.
Ou bien : Serai-je bientôt mariée ? - Oui ; avec ton petit brun.
Ou bien : Comment finira l'affaire de coeur qui m'occupe ? - Une coquette te supplantera.
Ou bien : De qui dois-je attendre la fortune ? - Des heureux que tu feras.
Ou bien : Que pense-t-on de moi dans le monde ? - Ne cherche pas à le savoir. (Quelquefois l'Oracle est moins poli, il répond : On te trouve prétentieuse).
Ou bien : Aurai-je ce que l'on m'a promis ? - Oui, si tu es sûre de toi.
Ou bien : Quel sera mon avenir ? - Tu regretteras le passé.
Ou bien : Quelle sera l'humeur de mon mari ? - Meilleure que la tienne.
Ou bien : Dois-je profiter de mes beaux jours ? - A ton âge on ne fait pas de pareilles questions.
Il faut avouer que les grisettes sont de bonnes personnes, n'est-ce pas ? Et ceux qui les ont tant calominées n'avaient pas sans doute visité, comme nous, leur bibliothèque.
LA FILLE ROUGEOLINA
«La fille Rougeolina, dite Petite-Clère ou la Tête de Veau, était attablée, dans un cabaret de la rue aux Fèves, avec la Muette de la Cité, quand tout à coup...»
N'ayez pas peur. C'est tout uniment un passage du journal de ce matin que nous venons de copier ; non pas un extrait du feuilleton, mais un simple fait-Paris, la chose la plus commune du monde. - Qui est-ce qui disait donc qu'il n'y avait plus maintenant ni mystères ni chourineurs ? Rougeolina, la Muette de la Cité, la Tête de Veau ! ne croirait-on pas avoir sous les yeux des personnages sortis tout palpitants d'un souterrain de mélodrame ? Soyez tranquilles, le pittoresque n'a pas seulement élu domicile dans le roman ; il y a encore, au fond de la vieille Cité, une douzaine de gaillards qui ne s'entendent pas mal à la triture des incidents dramatiques et qui, les bras retroussés jusqu'au coude, écrivent encore, dans le vin et le sang, des histoires toutes frémissantes de passion.
LES COMÉDIENS APRÈS LA COMÉDIE
Nous voulons parler des comédiens retirés du théâtre. Plaignons-les de tout notre coeur. En dehors de la rampe, ils ne traînent plus qu'une existence stérile et ennuyée ; ils ne savent que faire, ils respirent mal, on dirait qu'une machine pneumatique les oppresse. Nous avons vu Elleviou, marié richement, rôder autour de l'Opéra-Comique, avec des soupirs de tristesse et d'envie ; le moindre figurant à cinquante francs par mois lui semblait plus heureux qu'un empereur.
Nous avons vu Saint-Prix, dans sa maison de campagne des bords de la Seine, guetter des villageois pour leur réciter des tirades entières de Mithridate. D'autres, devenus rentiers ou maires de commune, reviennent de temps en temps se glisser dans les cafés obscurs, où ils serrent la main à leurs vieilles connaissances, la basse-taille de Moutauban, le trial de Nantes et cette éternelle famille dont les membres s'appelaient hier encore Florimon, Saint-Ange, Valsain, Belval, Mélincour, Doliban et Rosambeau. - De plus honteux et de plus tristes s'enferment dans leur cabinet ; ils tirent d'un coffre à secret le costume des jours anciens ; ils s'habillent comme pour la représentation ; mais qu'ils ont maigri, justes Dieux ! la culotte de peau des Deux Edmond grimace laidement sur les cuisses ; l'habit trop large pend, flétri, sur les épaules. - Ils marchent et se pavanent devant leur miroir ; à voix basse ils fredonnent un couplet sur le timbre : Du moineau qui te fait envie ; ils font de grands pas, ils tuent, ils pardonnent, ils maudissent, ils donnent et reçoivent des coups de pied, ils parlent à la cantonnade, ils rient aux éclats, et puis, s'apercevant soudain de leurs cheveux blancs, de leurs rides sur lesquelles le fard ne prend plus, de leur maigreur sarmenteuse, de leurs mains qui tremblent et de leur bouche édentée, les voilà qui ouvrent de grands yeux, qui s'arrêtent, et qui se laissent tomber sur le vieux coffre, - en pleurant.....
C'est qu'ils se rappellent ces nuits illuminées dont ils étaient les héros ; les doux regards des avant-scènes reviennent leur percer le coeur ; ils voient le souffleur dans son trou, inquiet, attentif :
- A propos, se demandent-ils, qu'est devenu ce pauvre Édouard ?
C'est le nom du souffleur ; ils s'attendrissent sur le souffleur et sur le concierge, et sur le chef d'accessoires, et sur le machiniste, bien qu'un jour il ait laissé tomber un arbre sur leur dos, puis un autre jour une maison tout entière. Mais bah ! c'étaient bagatelles, et comme ils seraient heureux maintenant si le même machiniste voulait bien avoir la complaisance de les écraser sous toute une ville !
Rien ne peut leur rendre le théâtre ni leur en tenir lieu, à ces âmes en peine ; le théâtre, cet enfer qu'on aime ! Rien ne vaut pour eux cette suprême jouissance de venir placer son oeil au trou du rideau et d'entendre les accords grinçants de l'orchestre. - N'oubliez pas de me donner ma lettre à la quatrième scène, lorsque je me trouve avec le vieux général. - Ai-je mon billet de logement ? dit Almaviva, au moment de faire son entrée ; et il se tâte. - Oh ! les beaux et furieux battements de mains ! Et, par-ci par-là les jolis rires d'enfants ! - Tenez (c'est toujours le comédien retiré du théâtre qui parle), il y a surtout en haut, dans un coin des quatrièmes, une jeune fille du peuple, mal vêtue, qui ne manque pas de venir un seul dimanche et qui écoute de toute son âme, les yeux fixes et brûlants, les mains crispées sur le rebord du paradis. Je la reconnais bien. Je ne le dis à personne, mais, voyez-vous, cette enfant, c'est mon talent, c'est mon ouvrage, c'est mon amour. - A la place où elle se mettait, j'ai coupé pieusement un morceau de vieux velours de la banquette.
L'AMOUREUX D'UNE OMBRE CHINOISE
Les Ombres Chinoises ont presque absolument manqué d'historiens, malgré le rang exceptionnel et bizarre qu'elles occupent dans les annales du théâtre. Bien peu de critiques se sont inquiétés jusqu'à présent de ces drames découpés en noir sur un fond lumineux, de ces petits personnages profondément fantastiques qui n'appartiennent ni à la classe des marionnettes, ni au peuple grossissant et multicolore des lanternes magiques.
Celui sur qui nous avions longtemps compté pour remettre les ombres chinoises en honneur, le seul d'entre nous qui nous parût spécialement apte à ce travail, c'était Edouard Ourliac, qui avait la parade et l'amour de Fantoccini passés dans le sang. Edouard Ourliac avait publié dans le Journal des Enfants une série de proverbes picaresques et napolitains qui témoignaient d'une vive connaissance du fil d'archal et du ressort.
On rencontrait souvent, bien souvent, Edouard Ourliac assis dans un petit coin du théâtre Séraphin, près du joueur de piano qui figure l'orchestre. Il était révérencieusement attentif ; et ses yeux non plus que ses oreilles ne quittaient la scène d'un instant. Il avait le rire approbateur ; et quelquefois il assista à deux représentations dans la même soirée.
Mais aujourd'hui l'auteur des Nazarille est mort, mort ainsi que Charles Nodier qui, lui aussi, avait de naïves tendresses pour le poëme du Pont Cassé.
Depuis des années, nous hantons la salle Séraphin et nous y goûtons de l'agrément comme une nourrice, de l'agrément sans remords et sans paradoxe. Jamais au sortir de la Chasse aux Canards la moindre pensée mauvaise ne nous est venue ; l'Ane Rétif a toujours laissé notre conscience pure et fraîche comme le jet d'eau du Palais-Royal, devant lequel nous passons en nous retirant. Les pièces du long des boulevards, où l'on se tue et où l'on crie, ne sauraient donner ce sommeil baigné d'innocence, à peine agité par une douzaine de silhouettes légères qui dansent en rond sur notre estomac.
Nous avons été pendant six mois amoureux d'une petite ombre chinoise qui avait un profil délicieux, et en guise d'oeil un trou par où passait la flamme de la coulisse. Sa bouche était mécanique, et s'ouvrait et se refermait avec un sourire que nous n'avons jamais trouvé que chez elle. De plus elle possédait un corsage dessiné supérieurement, une taille à fourrer dans une bague chevalière, et un jupon court qui montrait deux vrais pieds de Chine. Ainsi bâtie, babillarde et leste, elle nous ravissait l'âme. On distinguait à peine le fil qui la faisait mouvoir par en bas.
C'était une ombre chinoise toute neuve. Elle avait dû coûter quelque chose comme six francs.
Je l'avais vue débuter par le rôle de Fanchon, la marchande de bouquets, dans les Cris de Paris, cette pièce où j'ai toujours remarqué ces deux vers adressés à Polichinelle par un faraud, en costume de Cadet Buteux :
Si le cuir de tes reins a besoin qu'on le tanne,
Mon pied pour t'obliger fera l'offic' d'un' canne !
Elle eut beaucoup de succès et elle chanta le couplet final de manière à enlever les suffrages. Dans mon enthousiasme, j'allai jusqu'à me lever de mon banc et à lui jeter un bouquet qui rebondit sur la toile transparente...
Depuis cette soirée je ne manquai pas une seule de ses représentations. Parfois il me semblait qu'elle me saluait et me souriait imperceptiblement, lorsqu'elle se tournait de mon côté.
Il est vrai que chaque fois, claqueur solitaire, je ne manquai jamais de lui faire une entrée.
C'était une grande actrice. Elle avait de la verve, de la mémoire, quelques traditions ; elle savait principalement se tourner, ce qui est l'écueil des ombres chinoises inexpérimentées. Sur ma conscience, je crois qu'elle eût fait dans l'avenir un des talents les plus remarquables de Paris.
Pour moi j'en étais devenu fou. Je fis tout mon possible pour obtenir mes entrées dans les coulisses. Ce fut en vain. Je lui écrivis plusieurs billets doux qui restèrent tous sans réponse.
Cet état de choses durait depuis plusieurs mois lorsque un soir d'avril dernier, à mon vif étonnement, je vis apparaître dans les Cris de Paris une autre Fanchon que ma Fanchon, une autre bouquetière que ma bouquetière. Les bras m'en tombèrent. La débutante était massive, engoncée, sans grâce, sans tournure ; ses bras jouaient à tort et à travers ; elle remuait sans raison le menton et les jambes. Et puis son oeil était si mal percé !
Je n'attendis pas la fin de la pièce pour me précipiter hors de la salle, et je réclamai le régisseur.
Le régisseur, qui était l 'ouvreuse, parut.
Hélas ! il m'apprit que mon ombre chinoise était morte, morte sans rémission ! L'avant-veille elle s'était cassé un ressort ; et le directeur, ne voulant pas faire la dépense d'un raccommodage, l'avait supprimée et remplacée par la petite malheureuse que je venais de voir.
Un profond soupir sortit de ma poitrine, et je jurai de n'avoir plus désormais aucun amour de théâtre.
CE QU'ON ÉCRIT SUR LES MURS
On a, de tout temps, écrit sur les murs.
La première inscription de ce genre commence au Mané, Tecel, Phares, de phosphorique mémoire.
Le peuple, qui n'a pas de quoi payer un imprimeur, écrit sur les murs sa malédiction ou sa vengeance : A bas quelqu'un ou quelque chose !
En sortant des Tuileries, après la journée du 10 août, il écrit sur les murs : Magasin de sire à frotter. Plus tard, il colle au front de tous les monuments les trois mots sacramentels : Liberté, égalité, fraternité.
Pasquin et Marforio écrivaient sur les murs leurs diatribes ardentes contre la Rome des papes et des courtisanes.
L'exemple fut suivi dès lors par beaucoup de poëtes :
.... Tel autrefois Faret
Charbonnait de ses vers les murs d'un cabaret.
Voltaire écrivit les premiers chants de la Henriade sur les murs de la Bastille. Mais le gouverneur d'alors, qui n'avait pas le goût des autographes, - surtout dans un tel format, - fit étendre, après le départ du poëte, une couche de badigeon sur les quatre feuillets de son cachot.
Hoffmann barbouillait, de ses croquis emportés et de ses épigrammes au fusin, les tavernes de Berlin et de Dresde.
C'est un mot sur un mur : ÀNÀGKH qui a fourni à Victor Hugo son curieux roman dans le genre de Walter-Scott : Notre-Dame de Paris.
Dans les casernes, dans les tribunaux, dans les salles de spectacle, tout le monde écrit sur les murs. Voici la chanson d'un soldat, copiée sur les murs d'un corps de garde.
L'autre soir, je m'attardai trop
A tes côtés, belle Collette !
En vain, pour arriver plus tôt,
En te quittant j'ai pris le trot.
L'adjudant, qui toujours me guette,
M'a mis la main sur le garrot.
Il voudrait te faire la cour,
Et je m'aperçois qu'il enrage
De nous voir aller chaque jour
Vider un litre à Beau-Séjour.
Il bisquera bien davantage
Si tu me gardes ton amour. |
L'écolier écrit sur les murs de la cour de récréation, et en autres lieux : - Vivent les vacances ! et A bas les pions !
Il y a une vingtaine d'années, tout Paris était couvert du nom de Crédeville ; on ne pouvait faire deux pas sans que ce nom ne vous jaillît aux yeux. Les crédevillistes étaient alors partagés en deux camps : ceux qui écrivaient Crédeville tout court, et ceux qui écrivaient Crédeville, voleur. Mais ces derniers étaient des grossiers et des ignorants, qui ne possédaient pas la tradition Crédeville (on l'a su plus tard) était un officier de l'armée de la Loire qui, après la péripétie du grand drame de 1815, se réfugia, avec le général Gilly, dans les Cévennes, où, selon toutes les apparences, il aura trouvé la mort en combattant les royalistes.
La personne qui traça pour la première fois le nom de Crédeville sur les murs de Paris, ce fut une pauvre marchande de prunes, une aliénée, dont le visage gardait cependant encore des traces de distinction. Suivie et interrogée, on sut qu'avant la chute de l'Empereur, elle avait été fiancée à Crédeville, et que des revers de fortune, joints à l'ignorance où elle était du sort de son amant, avaient déterminé un ébranlement complet de toutes ses facultés. C'était le désir de retrouver Crédeville qui lui faisait écrire ce nom sur toutes les murailles. Le théâtre du Palais-Royal représenta en 1832 un vaudeville intitulé : Crédeville.
L'époque de Crédeville est aussi celle de la poire et du nez de Bouginier
On sait que la poire était la caricature de Louis-Philippe. Quant au nez de Bouginier, il est toujours resté pour moi un mythe inconnu.
Crédeville, la poire et le nez de Bouginie sont reproduits sur la plus haute des pyramides d'Egypte.
Ils ont été remplacés en ces derniers temps par Bonino, crétin ; lequel Bobino était, ou est, je crois, un élève de l'atelier de M. Picot.
Aujourd'hui, - ce qu'on écrit sur les murs, c'est : Durançon a le sac. Avoir le sac, c'est, comme on le devine, avoir de l'argent. Cette inscription se multiplie de jour en jour, et expose aux plus grands dangers M. Durançon.